Anouar Benmalek : Amour, beauté et violence dans l’URSS du XXe siècle (Irina, un opéra russe)
- Christiane Chaulet Achour

- il y a 2 jours
- 14 min de lecture

« Je ne pourrais pas ne pas écrire. Quand je n’écris pas, j’ai une inquiétude presque métaphysique jusqu’à me demander ce que je fais sur cette terre. Je dois écrire, un peu comme le fumeur qui doit fumer ou l’ivrogne qui doit boire. Moi, je dois écrire. »
(Anouar Benmalek, RFI 25 septembre 2021)
Ce roman russe est un roman algérien… d’un des écrivains algériens parmi les plus talentueux qui signe ici son dixième roman. Pour Djamal Guettala du Matin d’Algérie du 11 septembre 2025, c’est un incontournable de la rentrée littéraire… et il a raison ! « La force du roman réside dans la capacité de Benmalek à mêler romance intime et fresque historique ». Par cette formule condensée, le critique dit bien les deux grandes lignes de force du roman et de ses romans antérieurs.
Une courte biographie pour introduire à ce romancier pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas : Docteur d’Etat en mathématiques, il est né en 1956 à Casablanca, de père algérien et de mère marocaine. Journaliste et écrivain, il a été, après octobre 1988, membre du Comité algérien contre la torture. Après un début de publications en Algérie entre 1984 et 1986 [ un recueil de poésie, un recueil de nouvelles et un essai ; ainsi que son premier roman, Ludmila qui ne fait pas long feu dans les librairies à la demande de l’ambassade de l’URSS, le roman portant, comme Irina, sur le séjour de formation de cet étudiant algérien à Kiev], c’est en France qu’il publie Les Amants désunis en 1998 ( Prix Mimouni 1999, traduit en 10 langues, sélections Fémina et Médicis) ; en 2000, L'enfant du peuple ancien, roman, (Prix des auditeurs de la RTBF 2001, Prix RFO du livre 2001, Prix BeurFM-Méditerranée 2001, Prix Millepages 2000 ; ainsi que dans différentes sélections d’autres prix et une traduction en 8 langues). Depuis ont été édités six autres romans, Irina, un opéra russeétant le dixième. Parallèlement ont été publiés un recueil de nouvelles, un recueil de poésie, un choix de chroniques journalistiques, des entretiens et un récit autobiographique après le décès de sa mère ( http://anouarbenmalek.free.fr/). On peut trouver ces romans, tous réédités en livre de poche.
Ce n’est pas la première fois que la Russie – et plutôt l’URSS (dissoute en décembre 1991 : il fait ses études de mathématiques à Kiev à la fin des années 1970) – est présente dans l’écriture romanesque d’A. Benmalek. Mais ici, elle prend toute la place, le romancier précisant que l’invasion de l’Ukraine a bousculé son projet et qu’il a choisi de terminer son roman à la veille de cette guerre. On note alors qu’il situe tous les événements dans la Russie de l’ex-URSS.
Dans la « Première partie », le « Prologue » se décline en deux chapitres. Nous sommes tout d’abord à Leningrad en 1981 puis en France en février 2022. Le romancier trace ainsi le début de sa liaison amoureuse et l’enclenchement de la fin de cette histoire d’amour, dans un style un peu « fleur bleue » que l’écrivain reconnaît volontiers avec un certain amusement néanmoins (entretien VLEEL 399 des Rencontres littéraires en ligne du 10-09-25) : Walid, le protagoniste, les jours de profonde nostalgie, relit les lettres d’Irina : « Les rares jours d’optimisme, il parcourait surtout les premières pages, en se laissant griser par les phrases banales et magnifiques de tous les Roméo et Juliette, ou, étant donné le contexte, les Wronski et Anna Karénine du monde : Mon chéri, tu me manques à un point que tu ne peux imaginer… » etc… Dans le même entretien, Anouar Benmalek cite Aragon et Prévert comme ses poètes préférés. Souvent des vers d’Aragon me sont venus à l’esprit à tel ou tel passage du roman, comme le thème profond de la fiction : rechercher, au seuil de la vieillesse, la femme aimée quarante ans avant : « Un beau soir l’avenir s’appelle le passé. / C’est alors qu’on se tourne et qu’on voit sa jeunesse ».
Dans la « Deuxième partie », la plus longue et le cœur même du roman (7 chapitres et un épilogue, presque la moitié du roman), on passe d’un lieu à l’autre, d’un temps à l’autre selon les besoins de la narration et la grande adresse du romancier à surprendre son lecteur sans le perdre, tout en le guidant pour qu’il se retrouve dans ce labyrinthe d’un passé à tiroirs.
La première strate du passé se décline en une dizaine de mini-récits situés à Léningrad en 1978. Elle concerne Irina et Walid mais aussi un certain Vladimir dont on va comprendre assez vite qu’il est le grand-père d’Irina. Du couple inattendu – cette jeune Russe soprano qui ne rêve que d’opéra et cet étudiant algérien boursier en train d’écrire une thèse d’Histoire sur Napoléon – on apprend toute l’évolution de leur histoire, depuis leur rencontre insolite à l’agonie du grand-père : « L'amour est un état de confusion du réel et du merveilleux ».
Toutefois, avant de développer le Leningrad de Vladimir, il faut dérouler toute son histoire, ce qui est fait dès le premier chapitre mais cette fois en introduisant un décrochement temporel et spatial : la fiction se déplace en 1932 au Kazakhstan, dans la prison annexe de l’oblast de Karaganda. Autour de ces années, 1932-1933, A. Benmalek déploie l’inexorable descente aux enfers du jeune Vladimir, envoyé dans ce lieu comme bras efficace de la répression stalinienne (le NKVD, de triste mémoire), la manière dont il échappe lui-même à la répression (ce qui aurait mis un terme à toute l’histoire ! d’où l’épisode moscovite en 1932 aussi), le face à face avec Apaq, le héros Kazakh qui lui fait un drôle de cadeau, sa mutation à Leningrad et son retour à une vie de famille, construite néanmoins sur un mensonge, une dissimulation.
Dans la « Troisième partie » moins longue mais conséquente (4 chapitres et un épilogue), nous sommes à Saint Pétersbourg en 1992, pour découvrir la prise de conscience d’Irina à laquelle est dévoilée la véritable personnalité de son grand-père, la gravité des actes qu’il a commis et en conséquence, le changement de vie de la protagoniste.
La « Quatrième partie » enfin, (3 chapitres et un épilogue) ne peut être que l’épilogue de l’histoire du couple : on revient à Walid et son projet un peu fou de retrouver quarante ans après la femme qu’il a aimée, dont il n’a pas eu de nouvelles et dont personne ne peut lui en donner. A Saint Pétersbourg en février 2022, il retrouve Sacha dont il partageait la chambre à la cité universitaire, puis dans le Transsibérien pour « pister » Irina, jusqu’aux retrouvailles éphémères mais qui remettent passé et présent en connexion. Encore Aragon : « Il y aura toujours un couple frémissant/ Pour qui ce matin-là sera l'aube première/ Il y aura toujours l'eau le vent la lumière/ Rien ne passe après tout si ce n'est le passant ».
Nous le constaterons plus loin – lorsque je rappellerai des romans précédents d’Anouar Benmalek qui m’ont particulièrement marquée –, il y a toujours chez ce romancier une histoire d’amour singulière (dont les protagonistes sortent des sentiers battus et qui vivent des moments intenses mais sans avenir… sur le long terme en tout cas, « il n’y a pas d’amours heureux ») et un épisode violent et sordide de la grande Histoire qui épaule la première et lui donne son relief et son ancrage. Dans Le Soir d’Algérie (7-10-2006), l’écrivain déclarait : « j’écris en général en me basant à la fois sur une recherche historique approfondie et sur l’idée simple que les êtres humains, à travers les siècles, demeurent fondamentalement les mêmes, surtout en ce qui concerne les émotions de base : l’amour, la haine, la peur, la compassion ».
Dans Irina, cet événement historique est la famine au Kazakhstan voulue par Staline au début des années 1930. Mais l’épisode ne doit pas être traité comme dans un manuel d’histoire : il doit l’être à hauteur humaine. Le personnage de Vladimir trouve alors toute sa justification. Il y a la documentation et la manière dont elle est mise au service de l’imagination mais dans les limites du « mentir-vrai » : en savoir assez pour ne pas inventer faux ! Le calvaire des Kazakh est vécu par la présence de celui qui est apprécié par eux comme un guide, Apaq, et que Vladimir affronte dans la prison puisque c’est lui qui doit l’exécuter : ce sont des scènes qui dépassent le simple récit factuel pour plonger dans les consciences ennemies. Plus tard, le conflit des années 1930 trouve sa duplication dans l’affrontement des petites filles.
Toutefois, il faut encore d’autres connexions. L’autre élément qui structure le livre et appartient aux deux histoires (la petite et la grande) est l’opéra, sa beauté et son tragique qui habite la personnalité incandescente d’Irina. Le romancier trouve alors les espaces narratifs pour dire, sur ce pays qu’il aime, sa beauté extraordinaire dans de nombreux domaines et sa noirceur… Staline vs Tchaikovsky ! Car ce n’est pas simple d’écrire sur la Russie au moment où commence une guerre actuelle. Ce n’est pas simple non plus, dit Anouar Bemalek, d’être citoyen algérien et il faut créer le roman avec tout cela ! Pour lui, l’Histoire est un roman et, dans l’Histoire, des faits sont écrits et d’autres effacés, chaque historien choisissant sa perspective ; on ne peut pas parler d’objectivité (NB - on peut se reporter aux analyses de Michel-Roph Trouillot rappelées dans Collateral du 6 octobre dernier). Mais lorsqu’un événement aussi dérangeant vous tombe dessus et qu’il a été « silencié », il faut en faire quelque chose de sérieux, de documenté. On comprend que le temps qu’Anouar Benmalek met à finaliser une fiction est une période d’intenses recherches et lectures pour créer ensuite une atmosphère qui soit proche de ce qui s’est passé.
Il y a enfin, dans ce roman, un ingrédient qui n’appartient pas aux deux lignes de force indiquées, en lien avec l’obsession de l’écrivain sur le temps et ses mystères : le « cadeau » que Apaq fait au jeune Vladimir, celui de pouvoir effacer un présent dérangeant en faisant un saut-arrière dans le passé, ce qu’il nomme « les dérèglements dans la trame du temps » :
« – Dis-moi, fier bourreau de mon peuple, as-tu fait de mauvais rêves ces derniers temps ? De très mauvais rêves qui ressemblent à des souvenirs… ?
Vladimir sursaute, presque effrayé devant l’étrangeté de l’interrogation :
–Des rêves… quels souvenirs… ?
–Tu m’as déjà posé cette question et je t’ai déjà répondu. Reviens hier, fils… et je t’expliquerai encore une fois.
–Revenir hier ! Qu’est-ce qui te prend, vieillard ? Je t’ai déjà posé cette question ? Tu es gâteux ou la peur te fait perdre la raison ? Tu sais bien que tu vas mourir maintenant ! »
Et plus loin, avec l’angoisse qui l’étreint, Vladimir, homme de main du NKVD, qui n’a pas encore accompli l’exécution, écoute Apaq : « Alors Vladimir écoute l’homme soudain exalté. Et ce que ce dernier raconte est simplement impossible : par il ne sait quel procédé, il est, depuis une certaine nuit, capable de " revenir " en arrière. Dans le temps, précise-t-il sans se démonter. Avec Vladimir, affirme-t-il, il est déjà " revenu " deux fois ».
Il suffit de savoir que « l’âme est un hôtel noir où des choses horribles sont tapies » ; mais l’être humain ne peut résister « à la terrible envie de changer (son) destin ». Cela a un prix : le bénéfice immédiat du retour en arrière se paie lourdement dans la suite de la vie de celui qui a succombé à l’envie de jouer avec son destin.
Vladimir va succomber, terrifié après avoir vu une scène qu’il n’aurait pas dû voir et qui, en URSS, se paie par la mort. Il échappera à ce qui était inéluctable mais au retour en Kazakhstan, il passe d’homme de main à un agent zélé de la famine : « A tout cela s’ajoutait la famine dans le Kazakhstan, aussi destructrice, cette fois, par la volonté de l’homme, qu’une épidémie de peste noire au Moyen Âge, famine dont tout le monde se fichait, à Moscou comme à Alma-Ata, les ordres demeurant toujours de confisquer jusqu’à la dernière tête de bétail pour nourrir les ouvriers des grandes ville industrielles du centre de l’URSS ».
L’histoire de Vladimir, de sa jeunesse à son agonie, véritable dysthanasie (dans l’épilogue premier de la seconde partie), est passionnante à suivre et le romancier en tire une morale : « On ne touche pas à l’unique loi inaltérable du Cosmos – Le Désordre est une fonction strictement croissante du Temps ! – sans le payer chèrement. Un Dieu ne s’y frotterait pas ». La recommandation qu’il croit laisser à Irina ne peut lui être d’aucun secours, dans le temps présent… : « ne jamais souhaiter changer le passé (…) sinon le passé te dévorera, le passé est une malédiction ».
Et pourtant, le don, Irina en a hérité… Comment peut-elle vivre après la découverte de la vraie nature de ce grand-père tant aimé et de ces rêves-retours qui bouleversent sa vie. Elle en sera la proie avec l’agression de la petite fille d’Apaq, la revivant plusieurs fois, dont elle connaît le nom : son grand-père l’appelant ainsi « Bibigul ». Peut-être en fait-elle un vrai rêve de bonheur dans la séquence en Crimée avec Walid qu’elle n’a pourtant jamais revu depuis son départ. C’est aussi le « Final » : le rêve d’Irina côtoie le cauchemar de Walid, leur permettant à tous deux de s’évader du présent de leur vieillesse et de leur séparation. Cette réflexion sur le temps, mise en fiction dans la trajectoire des protagonistes, est la projection heureuse de l’histoire et aussi, peut-être la manifestation du désir de s’évader de la grande Histoire qu’on ne peut gommer mais dont la mémoire doit être documentée.
***
Difficile de ne pas indiquer, même brièvement, d’autres romans d’Anouar Benmalek dont la lecture m’a habitée longuement et vers lesquels il faut revenir. Tous ont des lignes de force semblables à celles que j’ai indiquées pour Irina, un opéra russe : une documentation solide avec, en son cœur, un événement tragique, effacé ou minimisé de la grande Histoire habituellement racontée ; et une histoire d’amour forte qui aboutit à une impasse.

Les Amants désunis, en 1998, a été le premier grand succès auprès des lecteurs. Il raconte le destin d’un couple, Anna, une Suissesse et Nassredine, un Algérien, dont l’amour fusionnel a été fracassé par l’Histoire de l’Algérie. Le récit se déroule en 1997 mais des fragments d’histoire antérieure parsèment le texte, en 1928 et surtout entre 1945-1955. Leurs deux enfants, Mehdi et Mriem ont été assassinés par des combattants du FLN. Quarante ans se sont écoulés depuis ce drame et la séparation du couple. Anna envoie un télégramme à Nassredine pour lui donner rendez-vous sur la tombe de leurs enfants dans son village natal. Sur la route, elle se fait enlever par les combattants d’Allah. A la date de 1997, le romancier ne dévoile pas un passé « silencié » mais met en relation la violence à deux étapes de l’histoire algérienne du XXes.

En 2000, c’est le second roman de l’écrivain à connaître un grand succès, L’Enfant du peuple ancien. L'intention première du romancier était de construire une fiction à partir d'un couple formé d'un Algérien et d'une Française, déportés en Nouvelle Calédonie, après les répressions de 1871, celle de la Commune en France et celle de la révolte d'El Mokrani en Algérie. Recherchant des informations sur les évasions des déportés vers l'Australie, il tombe sur une phrase qui ré-oriente complètement son projet : « "Le dernier loup de Tasmanie a disparu en 1870, en même temps que le dernier des aborigènes à la suite d'un massacre perpétré par les colons anglais"... Cette phrase m'a fait sursauter, car je venais d'apprendre incidemment le massacre de tout un peuple cité comme "détail" devant ce qui paraissait choquer l'auteur : la disparition d'un animal. Ce génocide, dans toute l'acception moderne du terme, devient à partir de ce moment le cœur du livre ».
C'est ce dernier des Aborigènes qui est l'enfant. Kader et Lislei, les deux déportés évadés, le trouvent sur le bateau de leur passage, enfermé dans une cage. Émus par la détresse extrême du jeune enfant, Tridarir, dernier représentant de la tribu de Tasmanie décimée par les colons, ils décident de le soustraire à la cupidité de ses ravisseurs qui veulent le vendre à d'étranges collectionneurs. Seule leur humanité commune les sauve de l'innommable. Notons que Tridarir, dépositaire à travers la mémoire de ses parents, de la mémoire de son peuple, refait les chemins des Rêves pour que sa terre ne disparaisse pas. Il n'entraîne pas ses "parents" adoptifs dans cette complicité culturelle-là. C'est une utopie autour de l'enfant "sauvage" que crée A. Benmalek en inventant cette famille métisse qui ne tente pas de syncrétisme mais qui, par amour, exerce sa tolérance.
Le roman d'Anouar Benmalek est un récit d'aventures fortement documenté où la prise de position de l'auteur est patente et voulue : « Les Australiens n'ont pas subi du tout le même opprobre au sujet de ce génocide que les Allemands au sujet du génocide juif. Les génocides ne sont pas égaux. Ma réaction a d'abord été la peur de parler de ce sujet auquel je ne connaissais rien. Puis une sorte de devoir éthique s'est mêlé à l'envie d'écrire. Il est alors devenu évident que j'avais à jouer le rôle de passeur de mémoire. J'ai dû tout réécrire en centrant le livre sur le génocide, avec la volonté de ne pas en faire un livre politique. »

En 2002, nouveau couple et nouvelle géographie avec L’Amour loup. La fiction se situe en 1987. Un étudiant algérien, Chaïbane, bénéficie d’une bourse à Moscou, que l’URSS donnait à des étudiants d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Il rencontre une autre étudiante boursière, Nawel qui est palestinienne. Ils tombent amoureux. Mais, à la fin de ses études, Nawel décide de rejoindre les siens. Chaïbane rentre en Algérie mais ne pouvant oublier la jeune fille, il décide de partir à sa recherche : il va en Syrie, au Liban et découvre la réalité de ces pays en proie à la violence et à la guerre. Il prend conscience de l’actualité et de l’Histoire des Palestiniens. C’est aussi la guerre civile libanaise, la vie dans les camps. Chaïbane retrouve Nawel dans un camp de réfugiés mais elle se fait tuer par un milicien.

En 2006, Ô Maria, est, pour moi, le roman majeur de l’écrivain. Cettte fois, il s’intéresse aux derniers musulmans d’Andalousie qui, de 1492 à leur expulsion au début du XVIIe s. (1604-1614), ont subi une répression et une exclusion de différentes manières. Ceux qu’on appelle les Morisques (musulmans convertis à la religion chrétienne) ont été pourchassés. Celle qui est au centre du récit est Maria (comme la mère de Jésus) qui n’appprend que tardivement qu’elle est musulmane et que son vrai nom est Aïcha (nom de l’épouse préférée du prophète). Elle vit, dans la colère et la révolte, l’assimilation religieuse, linguistique et culturelle qu’impose le catholicisme au pouvoir. Elle découvre sa langue d’origine (algarabia) pour pouvoir lire l’alcoran (le Coran). D’amours consentis en viols, la vie de Maria est faite de violences en pleine Inquisition. Le roman est dédié à « Gerónima la Zalemona qui vécut.à Torrelas (Espagne) à la fin du XVIes et dont la destinée me suggéra en partie celle de María ». Le roman s’ouvre sur le bûcher où brûle Maria-Aïcha,sous les yeux de son fils : « Le royaume de Valence est à présent quasiment purifié de sa vermine morisque, ces juifs aggravés d’islamisme, commme ils disent ici avec une moue semblable à celle qu’on forme lorsqu’on crache ».
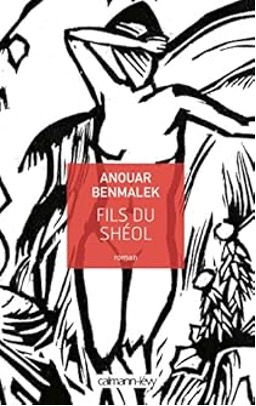
En 2015, le romancier se lance en territoire miné pour un auteur d’un pays arabe avec Fils du Shéol. Il a dit s’être interrogé sur sa légitimité à écrire sur la Shoah, à la fois par son origine, ce qu’il conteste mais aussi par le nombre impressionnant de livres écrits à ce sujet. Que pouvait-il apporter ? « Cette légitimité, je l’ai trouvée le jour où j’ai appris que le père de Goering avait été gouverneur de ce qui est devenu la Namibie (…) brutalité de cette colonisation (…) le génocide du peuple herero est demeuré largement ignoré ». Il y voit une sorte de préparation, à plus courte échelle, de ce que sera la solution finale en Allemagne nazie. Mais ce génocide n’a pas eu de conséquences sur le peuple génocidaire.
Mais comme dans les autres romans d’Anouar Benmalek, cette documentation historique et incrustée dans la vie de personnages et, en particulier de trois couples à partir desquels se dit la violence du monde. En trois générations de la même famille, sont vécus deux génocides.
On entre dans le roman avec le jeune Karl, enfermé dans un wagon à bestiaux. Il y rencontre Helena qui sera son bref amour puisqu’ils sont gazés en arrivant en Pologne Du Shéol, il peut regarder les siens. D’abord son père, Manfred, devenu Sonderkommando, qui rêve à son Élisa, la mère de Karl, rencontrée et épousée en Algérie des années auparavant. Remontant les générations, Karl découvre que son grand-père, Ludwig, a servi dans l’armée allemande du Sud-Ouest africain. Et qu’il a un secret : Hitjiverwe, une jeune femme héréro passionnément aimée, victime avec son peuple.
Comme les autres romans, malgré la difficulté extrême de ce qui est raconté, on lit sans quitter les pages de ce récit à la fois poignant et matraquant.
***
De roman en roman, Anouar Benmalek est un écrivain qui fait parcourir le monde et dépasse ainsi, par ses fictions, les frontières de son pays d’origine, ce qui n’est pas fréquent dans la littérature algérienne ; il n’oublie jamais ce pays, au détour d’une page, par un personnage ou une circonstance. Après de telles extensions géographiques et historiques, on suit la question que lui pose le journaliste Youcef Merahi, dans leurs entretiens, Vivre pour écrire, en 2006 :
« Quel est le pays où vous auriez aimé vivre ?
– J’aurais voulu vivre dans ce que j’appellerai, faute de mieux, le pays de mon enfance, quand je croyais encore que le sort du monde et de mon pays ne pouvait que s’améliorer, que la part du mal était condamnée à s’amenuiser, que la bonté était l’avenir de l’être humain. Je m’aperçois maintenant qu’un tel pays sur notre bonne vieille planète relève encore largement de l’utopie – et probablement, n’existera jamais.
Mais l’utopie est, bien sûr, nécessaire pour que nous puissions, vaille que vaille, accomplir le beau – en fin de compte – métier d’être humain ».
Anouar Benmalek, Irina, un opéra russe, Paris, éditions Emmanuelle Collas, 2025, 469 p., 22,90 €







