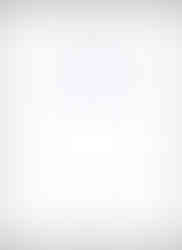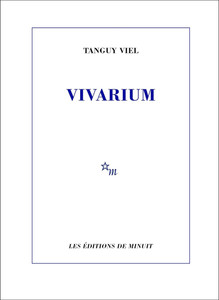Trois extensions de la poésie (Jean-Christophe Bailly, Dominique Fourcade, Tanguy Viel)
- Jean-Claude Pinson

- 22 avr. 2024
- 20 min de lecture

À quoi pense aujourd’hui la poésie ?
Démocratisée, nombreuse et « activiste », la jeune poésie, une poésie toute entière occupée du présent, s’empare des sujets de la plus brûlante actualité pour les « slamer » sur scène et démultiplier sur les réseaux ses rythmes nouveaux. La vita activa est son souci et son horizon, et elle ne manque pas de s’allier aux diverses mobilisations en cours. Vaste et bien visible est aujourd’hui le continent de cette poésie-là.
Mais il en est aussi un autre, celui d’une poésie davantage « pensive » peut-être (non que la première ne « pense » pas), tournée plutôt vers la vita contemplativa, poésie qui s’obstine à déployer, quand bien même nous sommes à l’époque de la « fin de l’hymne », quelque chose comme un chant – un chant dans l’épaisseur du temps et le prolongement de traditions diverses.
Trois pas de côté distincts
Temps réel, de Jean-Christophe Bailly ; ça va bien dans la pluie glacée ?, de Dominique Fourcade ; Vivarium, de Tanguy Viel : si je réunis, quoiqu’ils déplacent très différemment les frontières de la poésie, ces trois livres parus récemment, ce n’est pas seulement parce qu’ils appartiennent à un même « vieux » continent du poème écrit. C’est d’abord, bien qu’ils relèvent de poétiques apparemment fort éloignées, parce que, printaniers chacun à leur façon, tous trois font souffler beaucoup d’air frais dans le paysage actuel de la poésie (et plus largement de la littérature).
Tous les trois participent d’une extension de la poésie, mettant en œuvre cet « élargissement du poème » que Jean-Christophe Bailly appelle de ses vœux. Sans rien céder quant à la rigueur conjointe de la pensée et de l’expression, ils desserrent un corset du poème sans doute exagérément serré naguère par Mallarmé. Mais, comme y invite Dominique Fourcade, ils le font « durement », le flow redonné au poème ne diluant en rien l’acuité et la densité d’une langue s’inscrivant dans le temps long propre à la poésie pensive.

Chacun des trois, dans la monotonie du paysage de la poésie contemporaine, se singularise d’abord par l’invention d’une forme inhabituelle. Temps réel rompt ainsi avec la pratique dominante du poème bref et du vers court en recourant à un vers long que l’auteur définit comme « prose coupée » : « croquis, notations, brouillons, esquisses », chaque poème s’étend sur plusieurs pages « comme un sorte de tapis roulant semblable à ceux par lesquels les bagages/ sont délivrés dans les aéroports/ mais avec les valises ouvertes ». Enclin à une « pratique générique de la littérature » plutôt qu’à celle du seul poème, Bailly a un goût marqué pour l’allongement du vers, le serpent bariolé, ondulant, de la phrase, plutôt que pour la dispersion des mots, dressés comme autant de « signes debout » (Barthes), insulaires, hiératiques, sur la page. C’est qu’il préfère, comme Pavese, une poésie à la fois narrative et descriptive, soucieuse d’une concretezza préservant le poème « de toute inscription solennelle ».
Dominique Fourcade, lui, évoque frontalement, dans ça va bien dans la pluie glacée ?, la guerre aujourd’hui toujours en cours à Gaza. Il s’agit bien d’un long poème (et non d’un essai), même si, dans la sorte de prosimètre ainsi obtenu, les blocs de prose l’emportent de beaucoup sur les vers. Confronté au « test majeur d’ écriture » qu’est l’événement, le propos certes y est pleinement politique (« lost in carnage, lost in translation. le titre si marquant de l’éditorial du Monde samedi, “Israël se perd dans le carnage“ »), mais sous condition toujours de beauté et de chant : « je crois à la beauté », écrit Dominique Fourcade, à son incontournable possible, quand bien même, à l’occasion d’une exposition de photos, elle se présente comme « la chanson kalachnikée de notre époque ».

Vivarium, enfin, le livre de Tanguy Viel, non moins magnifique que ceux de ses deux aînés, pourra sembler quant à lui ne relever en aucune façon de la poésie. Écrit sans le moindre recours au vers, il fait en effet une part essentielle à la prose réflexive. Mais maints fragments, attentifs aux paysages et au temps qu’il fait, aux échos qu’ils éveillent dans « notre vieux fond végétal », en quête d’une « diction neuve des phénomènes », ont tout, quand ils délaissent un instant le registre réflexif, de haïkus allongés, substituant à la pensée « pensante » (celle qui construit avec les étais du concept) une pensée « pensive », où l’écriture se laisse porter par le Grand Tao du devenir, comme Bonnard obéissant à la Nature (ce que bien à tort lui reprochait, en peintre dûment prométhéen qu’il était, Picasso). À cela s’ajoute qu’avant ce livre, jamais Tanguy Viel n’avait eu recours au poème. Mais ce Vivarium est justement un livre de rupture, comme l’indique expressément, via une citation de T. S. Eliot, le premier fragment. Au bout de trente ans dévolus à l’écriture de récits loués pour le sens affûté de l’intrigue et la qualité de prose narrative dont ils témoignent, l’auteur déclare vouloir se tourner résolument vers « une forme plus pacifiée d’écriture » – entendons moins tendue par l’impératif de construction d’un récit conduit à son dénouement selon la plus stricte logique narrative.

Style tardif ?
C’est à propos du dernier Beethoven, en 1937, qu’Adorno introduit la notion de « style tardif » (Spätstil). La maturité des œuvres produites sur le tard par un artiste ou un écrivain ne peut être, écrit-il, comparée à celle d’un fruit mûr – la peau en est en effet ridée plutôt que lisse. Refusant les conventions en usage dans tel ou tel art, ces œuvres de rupture ne visent pas à l’harmonie des formes et à la réconciliation avec le monde. Pleines de fissures et crevasses, de césures et arrêts brusques, peu soucieuses de plaire, elles frappent bien plutôt par ce qu’Adorno nomme leur « puissance dissociative ». Il se peut aussi – c’est du moins la thèse qu’avance de son côté Hermann Broch, que ces œuvres, se dépouillant de tout un bagage rhétorique accumulé au fils des ans, en reviennent à une forme d’enfance de l’art : « Le peintre japonais Hokusaï, écrit Broch, atteignant le sommet de sa maîtrise vers quatre-vingt-dix ans, ne trouvait rien d’autre à dire que : “ maintenant je commence à apprendre comment tracer une ligne“. »
S’il est vrai que les avant-gardes, en art comme en littérature, ont fortement marqué de leur empreinte le XXème siècle, on pourrait dire alors que le style tardif, le style de rupture et de « puissance dissociative » qui leur est propre, fut de ce siècle la caractéristique majeure. Et en effet, quoique aujourd’hui défuntes, les avant-gardes ne sont pourtant pas tout à fait absentes. Comme le spectre de la pensée de Marx hantant nos sociétés, selon Derrida, à l’heure même de la déconstruction du marxisme, leur esprit ne cesse, et spécialement sans doute dans la poésie, de revenir hanter les écritures aujourd’hui les plus inventives, les plus éloignées des nouvelles conventions propres au champ[1].
Les trois auteurs ici par moi retenus ne sont pas stricto sensu des auteurs d’avant-garde (et d’ailleurs ne revendiquent pas ce titre). Toutefois, s’ils sont, chacun à leur façon, des « tard-venus » (« chasseurs-cueilleurs et tard venus/ nous tous et quelques-uns/parmi les plus pensifs », écrit Bailly), ils ne sont en rien des poètes d’arrière-garde (l’étiquette serait ici ridicule, sauf à en user à la façon de Barthes quand il se déclarait ironiquement « à l’arrière-garde de l’avant-garde »). Au contraire, quoique venant après les avant-gardes, ils en font fructifier l’apport critique sous la forme de l’invention d’un style tardif propre à chacun, creusant dans l’aujourd’hui de la langue et du réel des galeries qu’éclairent, plus ou moins vivement, les lueurs fantomales desdites avant-gardes.
Fantômes des avant-gardes
C’est sans doute dans l’œuvre de Dominique Fourcade que ce style tardif, sous la forme de la rupture d’avec soi-même, apparaît de la manière la plus constante. Avec une rare liberté, l’auteur n’aura en effet cessé, au fil de ses livres, de se défaire de ce qu’il pouvait y avoir de dogmatique dans les axiomes des avant-gardes. Ainsi de ceux du « textualisme », où le poème, en écho sans doute au fameux « il n’y a pas de hors texte » de Derrida, est déclaré « seul réel » (Xbo), et le sujet censé s’abolir pour laisser place au seul « muezzin du blanc » (Son blanc du un). Tout autre est sous cet angle la poétique d’un livre comme ça va bien dans la pluie glacée ? D’autres fantômes, ceux naguère répudiés du réel hors texte et du sujet, y reviennent en force pour inventer un nouveau ton, une nouvelle musique : « écrivain ou pas, admet cette fois Dominique Fourcade, je sais qu’on n’échappe pas à la dictature de soi-même ». Le « je » est en effet très présent dans ce dernier livre, quoique souvent sous la forme distanciée, « fictionnante », de l’élision (« quand j’étais gosse, j’zieutais les femmes mettre leurs corsets […] j’vous dirai pas si j’étais juif ou arabe quand j’faisais ça. Adulte je n’ai plus osé. Vieillard c’est impensable, on me pendrait, moi et mon érection »). La confidence autobiographique elle-même n’est pas absente : « j’ai deux petites-filles, et je ne voudrais en aucun cas qu’elles identifient en moi un grand-père désespéré ».
Ne pas se méprendre toutefois. Pas question pour Fourcade de retour vers quelque état antérieur de la poésie : « ne pas revenir en arrière, tel est l’instinct de la poésie moderne ». Le style tardif est un style qui, loin de regarder en arrière, ne s’attarde pas et file découvrir de nouveaux horizons. En l’occurrence, ça va bien dans la pluie glacée ? invente, ou plutôt réinvente (l’auteur rappelant opportunément Agrippa d’Aubigné), le genre difficile du poème politique. Et il le fait à la fois sans dérobade, en parlant clairement, ouvertement, de la situation politique la plus actuelle, la plus brûlante, mais sans jamais céder à la tentation de substituer au poème un quelconque message. On pourrait dire ici, mimant le goût de l’auteur pour les grandes enjambées métaphoriques, en écho à la musique du Maghreb, que tout se passe comme si, issu de la sphère arabo-andalouse, il en venait pour l’occasion à se faire chanteur de raï, n’hésitant pas à mêler à la langue savante (celle qui nous parle par exemple de la Vénus de Lespugue du Musée de l’Homme) la langue de la rue la plus triviale (« mais t’es con ou quoi/m’a dit un écureuil »). Citizen Do (titre d’un livre antérieur de Fourcade où coexistaient les références à Walt Whitman et à Char) se muant ainsi, à la faveur de l’événement tragique de Gaza, en Cheb Do.
Différent est le cas de Jean-Christophe Bailly. Certes, il lui a fallu dans un premier temps s’éloigner de la poétique surréaliste présente dans ses tout premiers livres ; en finir, écrit-il dans Tuiles détachées, avec « les ultimes filament de ce lyrisme sans preuves » dont il avait pu initialement se nourrir, pour chercher la voie d’un autre lyrisme. Certes, il s’est quant à lui toujours tenu à distance des axiomes du « textualisme ». Pas sûr, écrit-il dans un long poème de Temps réel, que la littérature, si jamais on la considère comme « une peinture de mots », soit vraiment « autonome » et « détachée des choses ». Il l’affirmait déjà à l’article « Dehors » de son essai Le propre du langage (1997) : « les noms conservent toujours une facette qui les tient hors de nous, dans la pure extériorité où ils ont dû commencer à vivre, en lui répondant. »
Mais surtout, si « style tardif » il y a chez Bailly, c’est, s’il se peut, dans un sens plus synchronique que diachronique. C’est transversalement que ce style concerne une œuvre qui, à première vue, semble être avant tout celle d’un essayiste, et la diagonale qui incarne cet éventuel style tardif est à chercher avant tout du côté des quelques livres relevant ouvertement de la poésie, notamment, avant ce Temps réel, dans Basse continue, paru en 2000. Car chaque homme, dit en substance l’auteur, est porté par une phrase ; une phrase infinie qui constamment l’habite et « va l’accompagner jusqu’à la fin ». Or cette phrase, dans l’écriture de Bailly, est « l’objet d’abord de la poésie ou celui d’un creusement allant jusqu’au nerf de la diction ».
Maints poèmes de Temps réel ont un caractère réflexif prononcé : « que serait/ l’équivalent du dripping pour l’écriture ? », demande ainsi le poème intitulé « Dans le champ élargi ». D’autres, en lien avec « le fond “je vois“ de toute parole », font signe en direction du cinéma et de cette technique du montage prisée par les avant-gardes russes des années 20 et 30. Le poème intitulé « Les Parques, version russe », évoquant Stalker, le film de Tarkovski, avance le mot russe de skaz. Or ce terme, introduit par les Futuristes, définit bien une poétique de la césure et de la ligne brisée. Le chahut tant sémantique que syntaxique qui en résulte, dénouant les ligatures, donne ainsi au sens une direction sans cesse imprévue. « Scénario discontinu [où] les rushes tombent comme des peaux », le poème, en recourant au skaz, bénéficie de la « puissance dissociative » de ce dernier.
Chez Tanguy Viel, ces fantômes des avant-gardes sont beaucoup plus discrets. Au niveau de la phrase notamment, on aura sans doute bien du mal, à trouver trace de cette « puissance dissociative » caractéristique, selon Adorno du style tardif. Si elle est présente dans Vivarium, c’est d’abord dans la composition d’ensemble, dans le recours à l’écriture fragmentaire, à l’élément de césure qu’elle implique et à l’inévitable contingence inhérente à la technique du montage. Le choix est ici clairement fait par l’auteur d’Apollon plutôt que de Dionysos : « moins aristocrate » que le second, « moins soumis à la fureur de son désir », Apollon « cherche un lieu où habiter, mais un lieu “commun“ ». « C’est pourquoi, poursuit Tanguy Viel, c’est à lui et à lui seul que nous confions la tâche d’écrire ».
Si les fantômes de l’avant-garde reviennent, dans Vivarium, c’est donc d’abord négativement, à la faveur d’une réflexion sur le rapport de la musique à la littérature. Comme beaucoup d’écrivains, Tanguy Viel a d’abord rêvé de pouvoir placer son écriture « sous le coup de cette intuition poétique » qui voudrait que « la musique cousine plus volontiers que les autres arts avec le fond propre des choses ». Mais bien vite il a compris que ce Rubicon-là ne pouvait être vraiment franchi. Les « tentatives les plus radicales d’un devenir-musique du texte » ont toutes été vouées à l’échec. « En littérature, c’est comme ça, il faut que l’œil s’en mêle, qui rendra commensurable notre place sur terre. C’est pourquoi, quelque trouée qu’il y fasse, quelque chahut qu’il y provoque, l’écrivain écrit dans la langue de tous, qui est la garantie du visible. Il use du vieux tissu des mots chargés de mille significations que, certes, il se targue de dépoussiérer ou de secouer comme les colonnes du temple, mais pour rien au monde il ne voudrait voir ledit temple s’écrouler. Pour rien au monde il ne voudrait que la musique qui pourtant l’habite et le porte ne provoque ce raz-de-marée qui risquerait de mettre la mer du langage à l’envers. » Et de conclure ainsi ce fragment : « Même Finnegan’s Wake ne fait pas de Joyce un joueur de flûte ».
Que faire ?
Dans sa Phénoménologie de la perception Merleau-Ponty notait, la distinguant du roman, que la poésie n’est « narrative et signifiante que par accident ». Elle fait plutôt entendre une « modulation de l’existence », tandis que le roman s’attache à un « événement interhumain » qu’il « laisse mûrir et éclater sans commentaire idéologique ». Là où le roman cherche plutôt à dire la vérité du monde social, la poésie est davantage soucieuse de la vérité de l’expérience sensible, – de la vérité de l’existence en tant qu’elle est « intonée », solidaire du jeu sans cesse fluctuant des affects et des percepts. Cette existence « modulée » par le poème est ainsi davantage, dirons-nous, « météorologique » que sociologique. En somme, le roman, enclin à traiter de « sujets de société » comme on dit aujourd’hui, est foncièrement balzacien. Tandis que le poème trouve sa quintessence du côté du haïku, le roman, proposant une fresque narrative de la « comédie humaine », est inévitablement amené à traiter de la « question sociale ». Son réalisme (celui exemplairement de Balzac) en fait un précieux adjuvant de l’analyse des luttes de classes qu’on peut trouver du côté du marxisme.
Si c’est bien dans une perspective semblable, lointainement balzacienne donc, que s’inscrivaient les romans de Tanguy Viel, il est clair que Vivarium introduit une rupture certaine. L’auteur le formule clairement : il entend bien résister à l’injonction du « tribunal politique » qui viendrait lui contester son droit au retrait. Il refuse, par-delà ce qu’il appelle son « communisme théorique », que soit assigné à la littérature pour « seul rôle » de se soucier « des affaires de la cité ». Il revendique au contraire le droit à « s’exfiltrer des affaires du monde », quitte à à ce qu’un telle attitude soit taxée de « frivole ».
Ce n’est pas qu’il soit insensible à l’injustice et à la misère du monde. Non, il est au contraire bien conscient du « partage inique des tâches » et de ce que lui doit, « luxueux » qu’il est, ce « temps de l’oisiveté » dont l’écrivain peut jouir. Observant des élagueurs au travail, l’auteur de Vivarium ne peut empêcher que lui vienne « un arrière-goût de privilège », et, notant que « Proust ne fut qu’effleuré par la “question sociale“ », n’ayant cessé de « regarder le monde derrière des vitres », Tanguy Viel affirme sans ambages lui préférer l’inconfort de Kafka et son « terrier inhabitable ».
Plus largement, au regard de la question politique (ou plus exactement de la « politique du poème »), il y a, du côté de la poésie « pensive », une intranquillité foncière. L’heure n’est plus semble-t-il à l’engagement d’antan. Chez Jean-Christophe Bailly, c’est autrement que trouve à se dire, dans le poème, en poème toujours, la question politique. Dans Temps réel, celle-ci apparaît sous la forme d’une basse discontinue, par intermittence, à distance de la vita activa, et au rythme lent qui est celui spécialement des trains russes. Car le voyage en train a le mérite d’instaurer dans le cours du temps comme une parenthèse qui favorise l’attitude contemplative et le retrait par rapport à un cours du monde affairé où commandent les exigences de la vita activa. On voudrait bien que dure cette suspension favorisée par le voyage, continuer, insouciant, de « faire la planche dans le cours du temps ». Mais se tenir « loin de tout est-ce possible ? » – Pas vraiment, car si « la magie du train, la mélancolie native du train » donne du présent « une image exacte », celle-ci induit un diagnostic qui chez Bailly penche davantage du côté de la seconde, la mélancolie. Par la fenêtre ce qui se donne à voir, c’est trop souvent « un enlaidissement du monde ».
Tout se passe, note l’auteur dans un poème écrit en « mode didactique » (« Réponse à une enquête »), « comme si le capitalisme libéral triomphant/ opérait en douce une révolution culturelle bien à lui:/ ne brûlant pas les livres mais les laissant lettre morte/ n’interdisant rien mais éteignant tout ». Demeure dès lors un devoir civique du poète : celui de « s’occuper du sens », là où tant d’autres « n’en font rien ou le pillent ». Et Bailly de préciser : « nous continuons nos travaux /qu’ils touchent l’époque ou s’en dégagent », […] « sans aucune arrière-pensée ou image/ de dernier carré ou d’avant-garde/ nous devons nous raidir et continuer d’aller sur de drôles de chemins plutôt lents ».
Si cette résistance du poème doit plus que jamais continuer, elle n’exclut pas toutefois qu’il faille, pour mieux justement s’occuper ainsi du sens, faire droit à la plus directe des proses. Et c’est bien ce que fait le bloc de prose qui tombe, en une brusque dissociation, au terme du long poème intitulé « Arc-en-ciel pâle (Russie, vers 1999-2001) ». Son titre (« Anéantissement du poème (Note écrite en décembre2022) ») n’est évidemment pas anodin : « l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes », y est-il dit, a fait subir à l’Histoire, « en ramenant au premier plan le visage le plus désespérant et le plus honteux du XXème siècle », une « irréversible hélas régression ».
Ce registre frontal, on l’a dit, est celui qu’adopte tout au long de son livre Dominique Fourcade. Pour autant, ça va bien dans la pluie glacée ? ne relève ni du discours politique, ni même de poésie engagée porteuse d’un message. On est bien en présence d’un long poème inventant une nouvelle façon de lier texte et contexte, une façon où « c’est le texte le contexte », comme le dit la quatrième de couverture. L’opération ne va pas sans acrobatie, mais n’est-ce pas après tout le propre de la poésie que de défier les lois de la pesanteur verbale ? En l’occurrence, le livre se présente comme une suite discontinue, celle de fragments non pas d’un « discours amoureux », mais de rupture amoureuse : « en un éclair début octobre 2023 je suis passé de l’interdit de ne pas aimer (l’Ukraine) à l’interdit d’aimer (ce qui se déchaîne en Israël/Palestine). pas facile pour un hippopotame. mon écriture a dû s’y faire, et produire, en somme un anti flirt avec elle. » (flirt avec elle, rappelons-le, était le titre du précédent livre de Fourcade, consacré justement à la guerre en Ukraine). Subvertir le registre du discours politique (en même temps d’ailleurs que l’habituelle logique énonciative du poème), cela passe aussi par l’effacement de la frontière entre auteur, sujet de l’énoncé poétique et personnage de fiction. C’est parfois très directement la personne de l’auteur lui-même qui parle, plutôt que le sujet lyrique, par exemple quand Fourcade cite « un mail d’Hadrien » qu’il a reçu (de son ami Hadrien France-Lanord). Mais il arrive aussi que le pacte de sincérité supposément propre à la diction lyrique vole en éclat, quand l’auteur, pour mieux parler depuis l’événement (et non en position d’extériorité ou de surplomb), se positionne en quasi-reporter de guerre : « ici, le désastre, octobre-novembre 2023, j’entre dans Gaza. » Et de poursuivre : « d’où j’écris ? j’écris de l’écriture/je suis un agent de l’étranger mon amour/ c’est mon amour qui est l’étranger/ c’est l’écriture qui est l’étranger ».
Une figure métaphorique sans doute résumerait cette poétique de l’inversion acrobatique, de son pouvoir subversif ; celle de l’élagueur (figure également présente, quoique dans un tout autre registre, chez Tanguy Viel) : « les élagueurs les pieds en l’air la tête en bas dans le grand frêne cet après-midi, de temps en temps le poème fait ça pour moi ».
« pays de Bucol »
Le retrait à l’écart de la vita activa, la recherche d’une forme apaisée de vita contemplativa, nous dit Tanguy Viel, n’est toutefois pas sans reste, au plan même d’un apport qui serait bénéfique à la vie commune de la Cité. Car dans son choix désormais assumé d’une vita nova d’auteur à l’écart du bruit et de la fureur du monde ne joue pas seulement son refus d’« effacer le souvenir des raisons profondes, asociales, qui [l’]ont poussé dans l’écriture ». Dans cette « vie assise » qu’est l’écriture, il croit en effet entrevoir « la lueur d’un autre éthos – celui que d’autres appellent frivole, mais que pour ma part je préfère dire poétique ». Il y voit même, à la limite, « la désignation d’un horizon paradisiaque, la compagnie d’êtres qui rappellent à chaque instant qu’un autre monde est là, à portée de nos cœurs », se demandant si ce n’est cela justement qui « sous-tend la nécessité de tous les combats ». Et l’auteur d’ajouter, quelques pages plus loin, qu’une « vie poétique » pourrait ainsi « orienter des pratiques, une disponibilité, une vitesse, un éthos, dont les modalités pacifiques viendraient court-circuiter l’état de souci permanent qu’alimente l’inflation de nos besoins ». C’est là formuler tout le programme de ce que j’appelle pour ma part une vita poetica. Il implique que nous retrouvions le sens du pacte pastoral qui jadis nous reliait à la Nature (« le pacte qui nous relie au sol », écrit pour sa part, sobrement, Tanguy Viel). Et « seule, ajoute-t-il, alors qu’il se trouve dans la gare de Hambourg, la poésie est capable de cela, pastoraliser le plus urbain des milieux ».
Maints fragments de ce Vivarium sont une façon de mettre en œuvre ce programme, de « rouvrir le dialogue » par exemple avec ces animaux sauvages (« un chevreuil un sanglier, un lièvre même, apparus au détour d’un sentier ») qui sont, en ce contact « archi-terrestre », comme des ambassadeurs que nous enverrait la Nature, pour mieux nous rappeler que nous lui appartenons. L’auteur dit ainsi dans ces pages, en de longues phrases à la ligne parfaitement claire, son goût, très gracquien, des paysages de préférence bucoliques, appréhendés non sans une once de mélancolie, suggérant qu’au fond « il n’y a peut-être qu’un genre littéraire caché sous tous les autres qui est l’élégiaque ».
La « question écologique » (si on peut l’appeler ainsi), fait comme on sait de longue date l’objet d’une réflexion déployée par Jean-Christian Bailly dans plusieurs de ses essais, notamment ceux qu’il a pu consacré à la question animale (Le Versant animal en 2007, puis Le Parti pris des animaux en 2013).
Maints poèmes de Temps réel déploient ce questionnement sous une forme où le registre essayistique à la fois introduit une césure dans le flux prosodique du vers long et en même temps s’y fond et vient conforter la démarche narrative et descriptive propre au poème. Ainsi en viennent à se quereller et cependant s’allier le constat lucide de la pensée critique et l’élan toujours enclin à une forme de lyrisme de la pensée poétique, pensée dont le chant, toujours circonstancié, est « daté du pays Bucol ».
Bailly n’hésite pas à s’attaquer aux thèmes apparemment les plus éculés de la poésie. Ainsi d’un poème intitulé « Conférence sur les fleurs ». Mais s’il évoque l’étrangeté de « la résistance des fleurs » « dans l’enlaidissement aggravé », ce n’est pas seulement pour en chanter la floraison (« l’explosion lumineuse au printemps ») ou le flétrissement (« le plus spectaculaire étant celui des iris ») ; ni même pour en déduire une méditation sur le passage du temps (selon un topos à ses yeux sûrement trop éculé). Ce sur quoi il insiste, c’est davantage sur la césure paradoxale qui fait qu’à la fois les fleurs ne sont pas tournées vers nous, mais cependant nous rappellent notre appartenance à ce monde du « sans pourquoi » et « sans intention qui nous porte ». Et si leur langage muet nous accompagne jusqu’au crématorium, « elles demeurent rétives à cette capture » et « les morts s’en vont bordés par la furieuse douceur de ce silence ».
Là où les tenants du négatif en font un impératif poétique catégorique ne souffrant pas d’exception, considérant qu’il n’y a lieu que de déplorer, de vitupérer et d’ironiser, Jean-Christophe Bailly s’attache, lui, à ce qui demeure dans la Nature source d’étonnement et de beauté échappant à l’entreprise humaine, à sa prétention à nier toute donation étrangère à son emprise prédatrice. Ainsi de la beauté gratuite du sphinx de la vigne, un papillon nocturne dont la « fragilité luxueuse » « rend heureux/ ceux qui ont la chance de le croiser ». « Étrange cadeau:/ sans destinataire et sans auteur/ un passage, un don à l’état pur. » Et le poème de se conclure ainsi :
« Partout dans le monde la guerre sévit et la violence cogne sur la pensée
l’interdit, la malmène,
j’essaye de comprendre alors ce que dit l’envoyé, le sphinx
mais il ne dit rien il est ailleurs
j’écoute quand même la question qu’il ne pose pas,
la question qu’il est – formée dans ce silence
où il volète éperdu en se posant parfois calmement. »
« Chant laïc »
« Malgré tout ce qu’il y a de fragile et de souvent nébuleux dans les discours “écosophiques“ d’à présent, il serait malhonnête, écrit Tanguy Viel, de ne pas y reconnaître les traits d’un nouveau grand récit surgi à la faveur des perspectives écologiques les plus redoutée, pour ne pas dire les plus avérées ». Toutefois, à défaut de pouvoir jouir du crédit qui fut celui, médiéval, du récit de la Jérusalem Céleste, ou de celui, moderne, du progrès et de l’égalité, le récit « écosophique » ne peut guère, reconnaît-il, qu’être « un simple récit de la survie : eschatologie sans autre échelle que celle des pompiers », récit « où l’on verra peut-être des poètes faire la courte échelle à des hommes d’action et même, allez savoir, réciproquement ».
Mais, demandera-t-on, quel pourrait bien être l’apport du poème à ce grand récit, s’il lui faut, enfant qu’il est de l’époque de la « fin de l’hymne », renoncer à cette vocation au chant qui longtemps fut sienne ? Telle est la question qui traverse l’œuvre de Jean-Christophe Bailly depuis au moins l’essai, paru en 1991, intitulé justement La Fin de l’hymne. La voix qui bruit dans L’infini, le célèbre poème de Leopardi, y note-t-il, est « la voix désormais non adressée de la nature : la rumeur fossile d’une harmonie perdue ». Dans un monde désormais sans dieux, la voix du poète est ainsi sous « contrainte non fabuleuse », assignée à « résider auprès du cœur des choses ».
Toutefois si l’exigence de sobriété requise par l’époque signe bien la fin de l’hymne, elle ne signe pas pour autant la fin du chant. Avec Hölderlin, après Hölderlin, note Bailly, si le lyrisme « se désagrège », il « se sauve » également, dans la venue de la prose, et de la prose dans le poème (Büchner et Baudelaire sont ici les deux noms convoqués par l’auteur). Et s’il s’y sauve, c’est que « le poème est la forme chantante du langage, la forme qui se souvient du chant » (et Bailly d’évoquer alors la « poussière de chant », un chant « brisé, déconstruit, pulvérisé », qu’on trouve chez Celan[2]). Mais « forme chantante du langage », le poème, en ce qu’il a de continu, parce qu’il est aussi « inclination (désir) », « confine, écrit Bailly dans le texte introductif de Temps réel, à une forme de vie qu’il détermine » (c’est moi qui souligne).
En d’autres termes, la propension au chant (au poème comme chant) est en l’humain une pulsion indéconstructible. On pourra ici songer à Rilke (« Gesang ist Dasein » – le chant est existence, mais aussi bien : l’existence est chant) ; ou encore à ce philosophe russe trop méconnu, Gustave Chpet (1879-1937), écrivant que l’homme n’est pas seulement cet être pensant (zoôn logôn echôn) dont parle la plus ancienne tradition, mais également un être « chantant[3] ». Si je relève la formule, c’est qu’elle consonne étonnamment, à travers les siècles avec cette phrase d’Épictète que Tanguy Viel relève dans son Vivarium : « Si j’étais rossignol, j’agirais en rossignol, naturellement ; si j’étais cygne, j’agirais en cygne. Mais en tant qu’être pensant, il me faut chanter l’Être. Telle est ma tâche ».
Constante est la présence du chant, du chant non fabuleux, dans Temps réel. Ou plutôt, constant son désir, constante l’orientation de son conatus vers une source hors d’atteinte où le poème cherche sa voix. Cette quête se déploie en longes séquences de poésie « pensive » – pensive plutôt que « pensante », car la pensée du poème contient un moment essentiel de passivité, se déployant à partir de la rencontre d’un dehors et non comme raisonnement procédant d’un sujet qui activement le conduit et le construit.
Ce peut être, par exemple, la rencontre d’un idiome étranger, rencontre qui suscite toute une méditation sur le temps (« ce temps qui fait eau de toute part »), où ce qu’aimerait entendre le poète ce ne serait ni des mots ni des phrases, ni même des chants, « mais le chant de la phrase en lui-même entendu » (dans le poème qui a pour titre « havâ/ zamân (de retour d’Iran, 2006) »). Mais, naviguant comme chacun désormais sur une « périssoire » (l’auteur a fait de la yole son emblème) semblable à ces « barques fragiles qui vont à la dérive », « je n’ai plus nul n’a plus la clé qui ouvrait le chant / qui l’ouvrirait encore à plus que lui », remarque, non sans mélancolie, le dernier poème du livre (« Répons »). Ce qui reste cependant, quand la « conduite épique » n’est plus possible, c’est un chant « discontinu ». Et si les poètes « ne fondent rien », du moins il leur reste la résonance, celle ainsi d’une citerne ou d’une retenue d’eau dont l’auteur garde le souvenir. Les légendes, avec la fin de l’hymne, se sont éloignées, mais néanmoins « un sillage demeure », qui fait que le poème toujours, parce qu’il en demeure hanté, peut se souvenir du chant.
Fourcade au fond ne dit pas autre chose : « merci Notre-Dame pour le lyrisme laïc de ton échafaudage », écrit-il dans ça va bien dans la pluie glacée ?. Et si Paris n’est pas Gaza, loin s’en faut, même à Gaza, et « plus que jamais sous les bombes », les enfants « ont besoin d’une scansion qui ne soit pas celle des prières. besoin eux moi du sensuel musical laïc des corps des mots pour que le vertige soit vivable ».
Jean-Christophe Bailly, Temps réel, éditions du Seuil, mars 2024, 232 pages, 21 euros.
Dominique Fourcade, ça va bien dans la pluie glacée ?, P.O.L, février 2024, 80 pages, 17 euros.
Tanguy Viel, Vivarium, éditions de Minuit, mars 2024, 128 pages, 18 euros.
Notes :
[1] Car il n’est pas sûr que ce style ait accompagné la démocratisation de l’art et avec elle l’apparition de ce qu’Antonio Negri nomme la « multitude des producteurs de beauté » (ce que j’appelle pour ma part le « poétariat »). – Parler d’ailleurs comme le fait Negri d’une « avant-garde de masse », c’est déjà employer une expression en soi quelque peu contradictoire
[2] La formule se trouve dans Passer définir connecter infinir, livre d’entretiens avec Philipe Roux, paru chez Argol en 2014.
[3] En russe : « Человек—поющее животное » (« tcheloviek – poiouchtchéié jivotnoïé »); c’est-dire, très exactement, « l’humain est un être vivant qui chante ».