Sophie Loizeau : "Ce que je souhaite, c'est que de plus en plus de terres soient mises à l'abri de toute prédation humaine"
- Lorna Blum
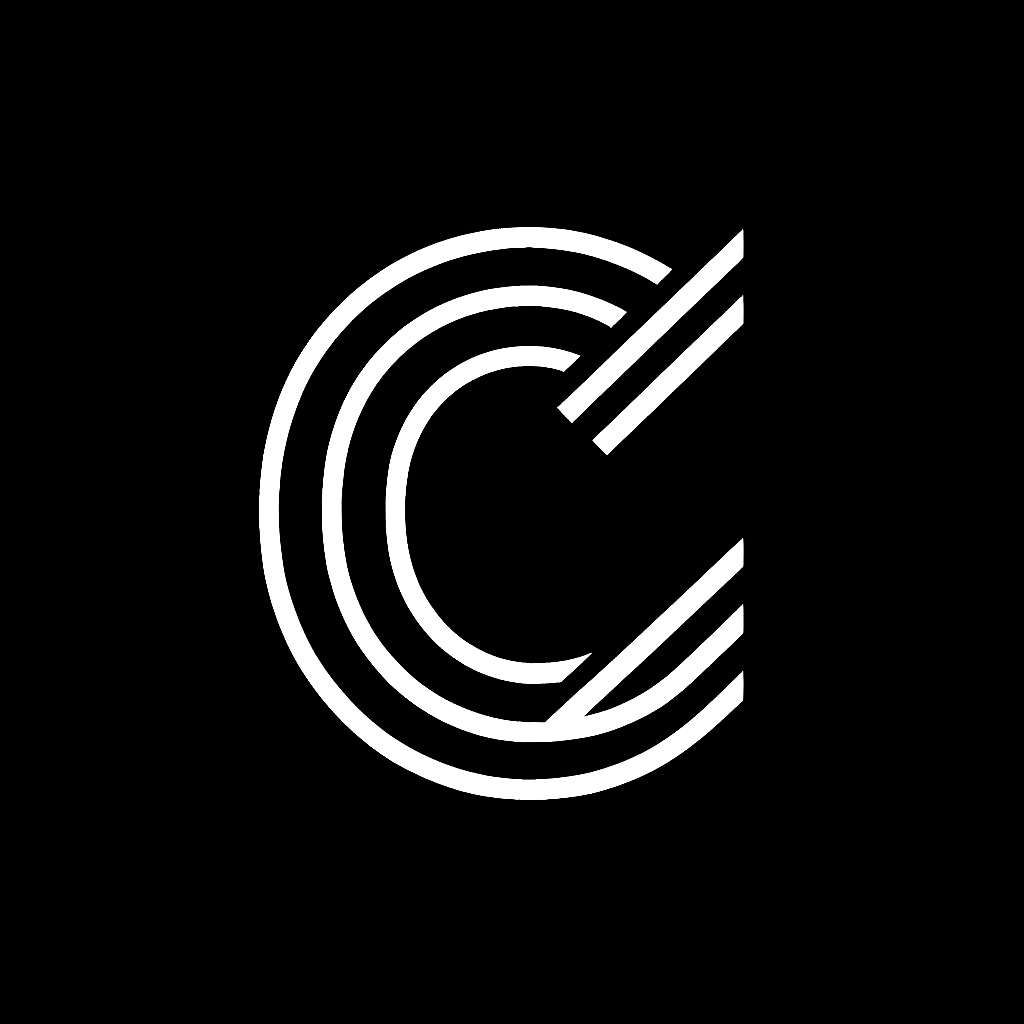
- 10 déc. 2025
- 7 min de lecture

Sophie Loizeau est poète, elle vit à Versailles. Son œuvre, constituée d’une quinzaine de livres, est marquée par la présence de la nature et des animaux qu’elle défend. Une nature qui fraye le fantastique et le mythologique, avec l’art sous toutes ses formes, avec le désir et la sexualité. Collateral vous propose d'ouvrir un dossier en deux temps : entretien et inédit de la poète autour de la question de la cause animale. Entretien, tout d'abord de Sophie Loizeau par Lorna Blum.
Lorna Blum – La thématique écologiste et écoféministe traverse toute votre écriture. D'où vient cette sensibilité ?
Sophie Loizeau – J'ai la chance d'habiter la nature et de bien la connaître. Depuis toute petite, je veux être au plus près des plantes et des animaux. C'est là qu'est ma place. Enfante, nous allions tous les WE dans la maison de mon grand-père à Arnouville-les-Mantes (devenue ma maison d’écriture). Mes parents nous laissaient une grande liberté pour jouer dehors. Je me souviens qu'un chasseur venait régulièrement offrir ses faisans, ses palombes à mon grand-père. J'allais me réfugier à la cave et je hurlais. J'étais scandalisée. D'emblée, la souffrance animale m'était insupportable.
J'ai d'abord éprouvé la nature avant de l'écrire. J'ai toujours ressenti une immense joie à me retrouver seule dans ces espaces. Dans les petits poèmes que j'écrivais à dix-sept ans, la nature était déjà là. Elle fait partie de mon émotion esthétique. Aujourd'hui, j'écris dans des enclaves – parcs, jardins fermés la nuit – comme dans des lieux ouverts, forêts, mer. Écrire la nature, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour la défendre, la faire aimer et respecter. Et pour faire revenir la joie. Ce que j'appelle « le don d'instase » : cette capacité d'écoute de la nature et d'attention quasi mystique à elle, qui passe par l'expérience profonde du silence et de la solitude. Écrire, c'est re-jouir. C'est faire revenir cette joie première, cette joie-jument, et la partager.
L. B. – Votre écriture alterne sans cesse entre différents registres : un ton familier qui ramène le mythe au présent, puis une langue plus incantatoire, traversée de voix animales et de visions. Comment vous situez-vous dans ces allers-retours ?
S. L. – Vers et prose poétique me travaillent, se mêlent. Dans mon premier recueil de nouvelles, Les Moines de la pluie, paru l'année dernière, je tire un vrai fil narratif en racontant des histoires fantastiques, mythologiques, féministes, écologiques, horrifiques. Avec mes Broderies (Le Mat & autres broderies, en cours – on peut en lire des extraits sur https://remue.net/sophie-loizeau-la-broderie-de-l-oiseau), je tresse plus serré poésie et narration.
La forme mouvante et libre me permet de dynamiser l'instant, l'immédiateté des paroles et des actes, les mouvements intérieurs et extérieurs des êtres, avec des raccourcis souvent, une écriture elliptique, tendue. J'ai aussi toujours lorgné du côté du fantastique, je ne m'embarrasse pas des vraisemblances : le renard parle, il donne son avis. Ce que j'aime, c'est être à la fois dans le plus concret possible, et puis basculer soudain dans l'improbable. C'est ce basculement qui crée le mouvement.
Le recours aux figures mythologiques chez moi est fondateur, et récurrent, avec Pan et Diane, mais aussi Thot, le dieu scribe magicien de l'Égypte ancienne. Cela me permet de déplacer les problématiques actuelles, comme la violence faite aux femmes et aux animaux, la défense du sauvage, et de proposer une autre perspective, imaginaire, symbolique, et pourtant très incarnée.
L. B. – Vous inventez aussi des formes linguistiques, comme le pronom « al » ...
S. L. – Oui. En France, je suis pionnière de la forme neutre en poésie, et de « l’écriture explicite » que j’ai appelé Le Pluriel équitable (V. ma tribune d’octobre 2024 de la revue en ligne Cunni lingus). J' ai inventé le pronom « al » avec l'écriture de Caudal[1] qui a commencé en 2009. Dans La Femme lit[2] qui est mon livre « manifeste féministe » débuté en 2004, je tente un renversement du patriarcat linguistique. Une révolution. Je cherchais une langue qui porterait tout le vivant, qui ne laisserait ni la femme ni l'animal sur le bas-côté. Le féminin ayant toujours été là, sous le masculin, mais caché, invisibilisé. Ma réparation a été de l'en sortir. « Al / als » est le fruit de cette poétique du neutre capable de rassembler le féminin, le masculin, le neutre asexué de l'humain, et l'animal.
L. B. – Cette volonté de faire advenir le féminin se prolonge dans votre lecture des mythes. Votre titre « Artémis n'a jamais chassé que les chasseurs » est-il une façon de défaire la lecture patriarcale qui a fait d’elle une figure de domination ?
S. L. – Tout à fait. Pour moi, Artémis ne chasse que les voyeurs. Elle est d'abord une femme offusquée : sa liberté d'être seule (sa capacité à jouir d’elle-même), est mise à mal par l’intrus. L'image de Diane au bain matée par le chasseur Actéon a été la pierre angulaire de mes réflexions, non seulement sur la visibilité du féminin dans la langue, mais aussi sur la joie de la femme dans la nature, délivrée du regard de l'homme. Le voyeurisme est un viol, qu'Artémis en déesse punit sur l'heure. Puissance du féminin poussée au mythe pour une action militante à son maximum du langage. Ça revient dans mon travail : la solitude dérangée, souillée.
L. B. – Artémis est blessée par un cerf mal anesthésié, et cette blessure marque une prise de conscience. Quelle place tient la vulnérabilité dans la lutte contre la domination ?
S. L. – L'empathie, c'est d'abord reconnaître ses propres limites et sa propre vulnérabilité, et donc forcément les reconnaître chez l'autre. S’identifier aux bêtes est le seul moyen d'évolution. Si on s'identifie à la bête, on lui reconnaît une sensibilité, une individualité, une personnalité. Et si on peut compatir au destin des animaux, si on arrête de les dominer, de les manger, de les traiter comme on le fait, cela entraînera tout le reste. Et il y aura des interdits qui se mettront en place : le respect de la vie de l'autre, dans sa différence, coulera de source.
L. B. – Le collectif SPT, Stériliser Plutôt que Tuer, incarne la volonté de trouver une alternative à la violence, mais finit par la reproduire. Comment sortir de cette impasse ?
S. L. – Je pense que le mieux, c'est de laisser faire la nature. Cela implique de nous frustrer, de nous retirer pour rendre son habitat à l'animal sauvage. Le gouvernement actuel fait tout le contraire. Il y a, par exemple, ce projet de décret – auquel on peut peut-être encore dire non via la consultation publique en ligne – qui a pour finalité d'affaiblir le statut d'espèce protégée (animaux non domestiques et plantes non cultivées). Si les renards dérangent, on les descend. Si le loup s'attaque aux moutons, on le tue, si la forêt gêne l’agriculture, ou les promoteurs, on la rase. Les activités économiques priment sur le vivant. On ne se pose même plus la question d'essayer de trouver des solutions. On sait protéger correctement les troupeaux : présences humaines sur place, chiens, clôtures, colliers anti-loup… Des associations comme l’ASPAS, la LPO n’ont de cesse de proposer des solutions pérennes et respectueuses. Mais la préservation de la biodiversité n'intéresse pas le pouvoir en place. Dans Sanctuaire, mon prochain livre certainement le plus engagé, qui paraîtra en 2026 aux éditions Lanskine, j'expérimente un absolu de la libre évolution. Ce que je souhaite, c'est que de plus en plus de terres soient mises à l'abri – sanctuarisées, protégées de toute prédation humaine. C’est le seul moyen. Avec les révolutions, les soulèvements des peuples.
L. B. – Pensez-vous qu'il soit possible de retrouver un équilibre entre les vivants ?
S. L. – C’est trop tard, je le crains. Dès le début, il y a eu confiscation des pouvoirs. Le mâle humain n'a pas voulu partager avec sa compagne. Il l'a violée, humiliée, frappée, privée d'instruction, maintenue en captivité, dominée exactement comme il a dominé l'animal.
Le mot « réification » est très important. Descartes a réduit l’animal à une chose machinale, instinctive, pour justifier son exploitation. Il l’a prouvé en pratiquant la vivisection (pratique scientifique courante à l’époque). Les hommes, quand ils veulent asservir un peuple, le traitent en animal – on l'a vu, par exemple, avec le gouvernement israélien sur les Palestiniens. Et vice-versa, car je n’oublie pas la boucherie du 7 octobre 2023 commise par le Hamas. En Afghanistan, les femmes et les filles peuvent être vendues, échangées. En toute impunité puisque ce sont des objets, des animaux. Dans réifier, il y a la volonté de priver l’autre de son humanité, de le/la dégrader, de l’instrumentaliser pour mieux le/la soumettre et l’anéantir dans son être même. Cette justification perverse tend à se généraliser dans les conflits. Les salauds tiennent le monde. Ces hommes-là, les salauds, ont toujours été là, aux commandes. Et tout a été gâché. On a raté notre tour sur cette merveilleuse planète.
Sophie Loizeau est poète, elle vit à Versailles. Son œuvre, constituée d’une quinzaine de livres, est marquée par la présence de la nature et des animaux qu’elle défend. Une nature qui fraye le fantastique et le mythologique, avec l’art sous toutes ses formes, avec le désir et la sexualité.
Parmi ses livres : Poèmes paniques, auto-anthologie 1999-2020, Lanskine, 2024 ; L’Ile du renard polaire de To Kirsikka, Champ Vallon, 2024 (Grand prix SGDL de poésie 2025) ; Les Moines de la pluie , Le Pommier, 2024 (finaliste du prix SGDL du premier recueil de nouvelles Christiane Baroche 2024) ; Les Epines rouges, Le Castor Astral, 2022 ; Féerie, Champ Vallon, 2020 ; Les Loups, Corti, 2019 (Grand prix Vénus Khoury-Ghata 2020) ; La Trilogie de diane : Caudal, Flammarion, 2013 (Prix François Coppée de l’Académie Français 2014) ; Le Roman de diane, Poésiefiction I, Rehauts, 2013 ; La Femme lit, Flammarion, 2009…

Notes
[1] Flammarion, 2013
[2] Idem, 2009.







