Dario Ferrari : Une satire irrésistible du petit monde universitaire (La Récréation est finie)
- Cécile Vallée

- 23 sept. 2025
- 7 min de lecture

Après le fantastique Uvaspina de Monica Acito, les éditions du sous-sol nous proposent un nouveau roman italien tout aussi réjouissant et détonnant. À travers le narrateur, un adulescent provincial, Dario Ferrari croque le tout petit monde universitaire italien aussi bien que le britannique David Lodge l’avait fait. Cependant, au-delà de cette satire douce-amère, ce sont les années de plomb qu’a connues son pays entre la fin des années 1970 et le début des années 1980 que Dario Ferrari interroge en jouant sur différents niveaux de narration, dans des mises en abyme vertigineuses et réussies, tout en menant une intrigue prenante et originale.
« Certains choix conditionnent toute une vie et, jusqu’à présent, j’ai toujours eu tendance à faire ces choix-là au hasard. »
Marcello se présente comme un adulescent provincial de la dernière génération du 20e siècle. Il a mis dix ans à décrocher son Master de Lettres avec un mémoire sur Kafka parce que les cours de littérature allemande sont ceux qui l’avaient le moins ennuyé et qu’il trouvait le professeur sympathique. À trente ans, il est toujours étudiant et vit chez sa mère, professeure d’histoire de l’art, divorcée de son père qui tient un café qu’il destine à son fils. Mais Marcello est sûr d’au moins une chose dans sa vie, c’est qu’il ne veut pas reprendre le café de son père. En revanche, il ne sait pas ce qu’il veut faire d’autre. Il passe son temps entre des beuveries avec sa bande d’amis et Letizia, sa petite amie depuis le baccalauréat. Comme elle est très engagée dans ses études de médecine pour devenir oncologue, elle s’accommode du peu d’engagement de Marcello. Quant à lui, il reconnait qu’elle est sa Boucle d’Or, la « plus-que-parfaite » même s’il sent parfois « une sorte de reproche indirect adressé à [sa] vie sans queue ni tête » qui lui fait davantage penser à « Jiminy Cricket ». Cependant, quand elle l’accuse d’être « inaffectif » et de vivre sa « vie comme si c’était celle de quelqu’un d’autre », quelqu’un qui ne l’intéresserait même pas, Marcello estime plutôt qu’il ne se trouve « pas assez intéressant pour mériter [sa] propre attention ». En inversant la phrase d’Italo Calvino dans Le Vicomte pourfendu – « Parfois on se sent incomplet et on est tout simplement jeune » – il nuance la posture bravache de l’adulescent.
Par un concours de circonstances, Marcello devient doctorant malgré lui. Quand son père lui offre un livre pour préparer un concours administratif, il l’esquive en lui annonçant qu’il veut faire un doctorat. Il participe donc au concours pour obtenir une bourse et finit troisième. Comme la première admise se désiste pour une autre université, il est accepté. Son directeur de thèse, le chef du département, refuse ses propositions en lui rappelant qu’il fait un doctorat pour entrer dans un « monde professionnel très réglementé et même codifié ». Il lui propose, avec insistance, un sujet sur les œuvres d’un révolutionnaire des années 1980, Tito Sella, auteur obscur dont les archives sont en France. Il lui fait miroiter un texte autobiographique à découvrir, La Fantasima, et un séjour en France. Marcello pénètre ainsi le cercle réservé de la cour de Sacrosanti, fondateur du département « italianiste comparatiste », oxymore créé pour asseoir son pouvoir.
« Je découvrirais notamment que l’université est un monde psychotique, qui possède un très faible sens de la réalité, peuplé d’individus à la réputation extrêmement circonscrite (quelques microzones de leur microchamp d’expertise*), qui opèrent dans un secteur marginal et totalement démuni comme celui de la culture, et qui se prennent néanmoins pour des rock stars, avec des egos et des comportements à la hauteur de cette conviction. »
C’est Pier Paolo, thésard comme lui, mais au fait de tous les arcanes universitaires, qui l’initie aux « intrigues et sous-intrigues du petit monde académico-littéraire italien » dont l’énumération d’une demi-page à la Calvino est savoureuse :
« [...] qui a étudié avec qui, qui ne supporte pas, qui a volé la femme de qui, qui a plagié qui, qui ne vas pas aux conférences de qui, [...] qui écrit un article dans la revue éditée par qui dans le but de renvoyer l’ascenseur à qui et de libérer un poste pour qui en mettant des bâtons dans les roues à qui. Quand ces systèmes d’équations ont atteint cinq inconnues, j’ai cessé de le suivre. »
Il lui explique également « comment écrire un article universitaire (et, surtout, qu’est-ce que c’est en réalité) » : « en gros, 20% de culture et 80% de relations publiques ». Pier Paolo affirme qu’on n’écrit pas un article pour dire quelque chose mais pour l’ajouter à son CV et même quand on a quelque chose à dire, il faut surtout « faire comprendre qu’on a la crédibilité nécessaire » en s’adossant à ce qui a déjà été publié. Les notes sont donc essentielles, elles doivent citer le directeur de thèse et ses poulains, en veillant à ne pas citer ses opposants et leurs poulains, mais aussi ceux qui ont du pouvoir avec des adjectifs mélioratifs – « fondamental », « incontournable », « lumineux » – en fonction de leur statut. Pier Paolo conclut :
« Dans ce système différentiel, tu dis certes la petite chose que tu as à dire sur le Sonnet XXIV de Pétrarque, mais dans le même temps tu lances des déclarations de guerre, tu noues des alliances, tu t’inscris dans des équilibres de pouvoir. »
Le colloque universitaire n’échappe pas à la satire. Marcello, qui est nommé par son directeur de thèse assistant d’une autre doctorante pour organiser le « Xe colloque d’études italiennes comparées », découvre les caprices des professeurs, les stratégies à mettre en œuvre pour les placer à table, les termes pompeux pour leur adresser des mails, l’implicite de leurs échanges, après leurs communications, dans lesquels « savant » signifie « ennuyeux à mourir, bien qu’érudit » et « fascinant » est synonyme d’« inconsistant ».
Cette satire irrésistible du petit monde universitaire, portée par la verve du narrateur, ne remet toutefois pas en cause les études littéraires. Le narrateur dénonce les difficultés des étudiants, même les plus brillants, à trouver une place à l’université :
« des gens à qui, il y a trente ans, on aurait gardé une place au chaud à l’université avant même qu’ils ne soutiennent leur thèse, qui se battent à présent pour ramasser des miettes et qui, dans quelques années, enseigneront l’italien et l’histoire dans la plaine du Pô, au lycée technique Gino-Bartali, un bahut où tout le monde parle dialecte, où on jure comme des charretiers, et où les enseignants sont le dernier échelon de la hiérarchie sociale et humaine. »
Il donne un exemple tragique de ce parcours du combattant à travers le personnage d’un docteur, passé de contrats en contrats, en attendant le poste qu’on lui fait miroiter pendant des années, qui se suicide quand il n’obtient rien à la dernière campagne, sacrifié par des calculs de consolidation de réseaux.
De même, si Marcello se moque des travaux universitaires sur les œuvres littéraires qui peuvent n’être qu’un prétexte à « exhiber ses propres compétences herméneutiques infinies et narcissiques », quand Sacrosanti fait sa communication en plénière, il se dit en « quasi-extase et contemplation révérencieuse » pour son mentor :
« Dès que Sacrosanti a commencé à parler je me suis réveillé et, en un instant, je me suis rappelé pourquoi, malgré tout – malgré l’absence totale de reconnaissance sociale, malgré l’inutilité totale d’un diplômé de lettres dans le monde du capitalisme néo-libéral, malgré l’assommant examen de philologie romane et la connasse de l’examen de linguistique générale, [...], malgré tout ça, j’ai choisi et je choisirais peut-être encore d’étudier la littérature. »
De « la perméabilité entre la vie et la littérature »
Dans un entretien accordé au site italien LuciaLibri, Dario Ferrari explique qu’il a choisi « une perspective transversale et biaisée » pour interroger les années de plomb en Italie. Il invente, en effet, un personnage fictif de terroriste écrivain : Tito Sella, membre de la Brigade Ravachol, de 1978 à 1980, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité après leur dernière action qui se solde par un meurtre. Marcello fait donc ses recherches sur un personnage et une œuvre fictifs qu’il complète lui-même par la réécriture, à la troisième personne, de La Fantasima, l’autobiographie disparue de Sella, qui est au centre du roman. La perspective est, de ce fait, doublement biaisée et transversale, d’une part, par la fiction et d’autre part, par l’interprétation de Marcello dans ses travaux de recherche académiques et littéraires. Il voit ainsi dans les deux personnages du Goût de la neige le paradoxe de Sella : « un Sella théorique et politique, qui affirme la nécessité de l’action violente contre un ennemi monstrueux, raillant ceux qui tergiversent et hésitent ; et de l’autre un Sella narrateur, qui se range plutôt du côté du personnage irrésolu, dubitatif et incapable d’agir, en recourant à tous les outils narratifs à sa disposition ». Dans sa version de La Fantasima, il décrit un Sella hésitant quand Barabbas les pousse à passer à l’action. Même s’il est convaincu que « la société est fondée sur l’exploitation impitoyable du prolétariat et qu’un changement radical, c’est-à-dire son renversement, est nécessaire, il n’était pas tout à fait certain ni qu’une guerre civile soit en cours – dans laquelle tuer n’était qu’un acte banalisé – , ni que cela vaille la peine de se battre pour la société que les idéologues comme Barabbas appelaient de leurs vœux ». Si Marcello soulève les paradoxes des activistes des années de plomb à travers Sella et ses acolytes, il est encore plus pessimiste quant aux velléités de ces contemporains :
« Comment se peut-il qu’en un peu plus d’une génération et demie les perspectives aient si radicalement changé ? Est-ce uniquement parce que la victoire du capitalisme est si écrasante que nous sommes incapables d’imaginer ne serait-ce qu’un début de solution alternative ? ou bien parce que, eux se sont retrouvés, au beau milieu d’une tempête idéale, avec la certitude qu’on ne pouvait rien envisager d’autre qu’une nouvelle guerre, que la révolution se faisait dans le sang et pas en poussant la chansonnette ? »
Le titre, citation de De Gaulle en mai 1968, détournée par Barrabas quand il lance l’action terroriste contre un juge, fait également écho au désenchantement de Marcello qui se définit, à travers Sella, comme appartenant à une « catégorie en suspens », celle des « non-alignés, des incertains, des dubitatifs, de ceux qui n’arrivent pas à se décider ou qui ne se décident qu’à moitié, de ceux qui voudraient être intègres mais n’en ont pas la force, qui font tout capoter au dernier moment parce que leur vocation n’est pas le triomphe mais la poursuite d’un fantasme, et qui, finalement, ne peuvent que regarder ou raconter ».
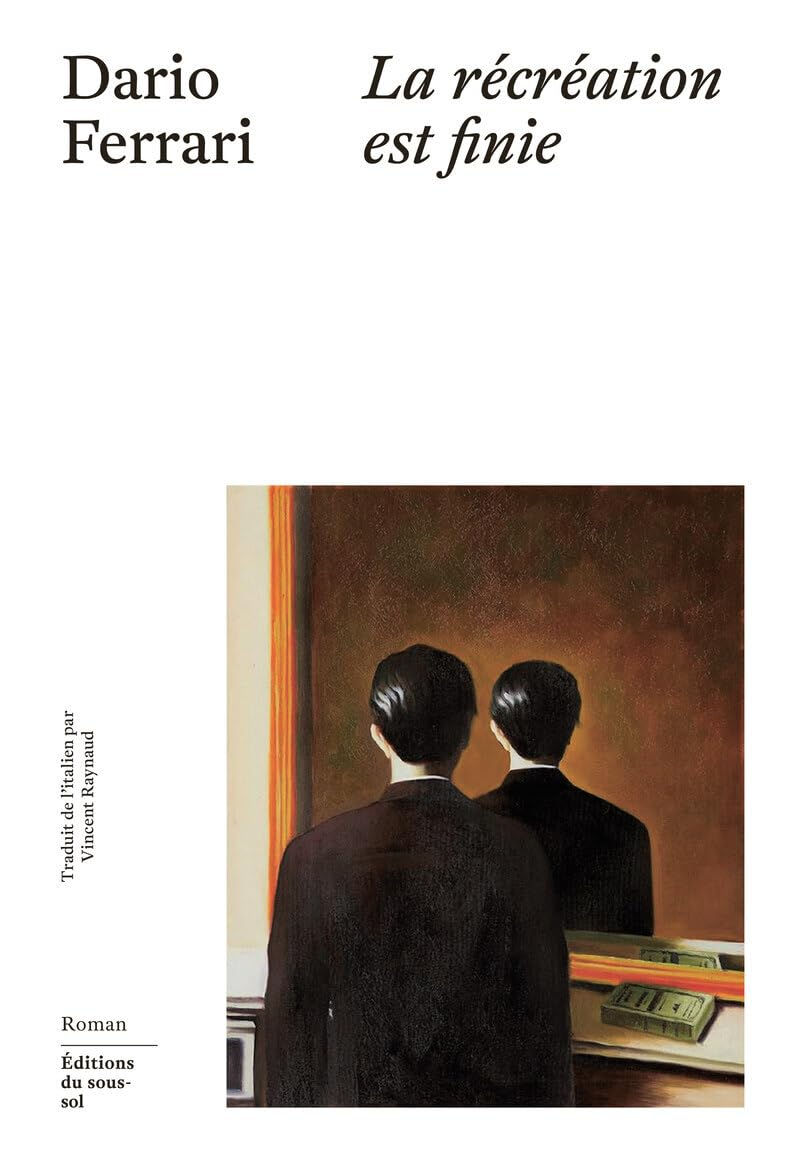
Dario Ferrari, La récréation est finie, traduction de Vincent Raynaud, Editions du sous-sol, août 2025, 448 pages, 24 €.







