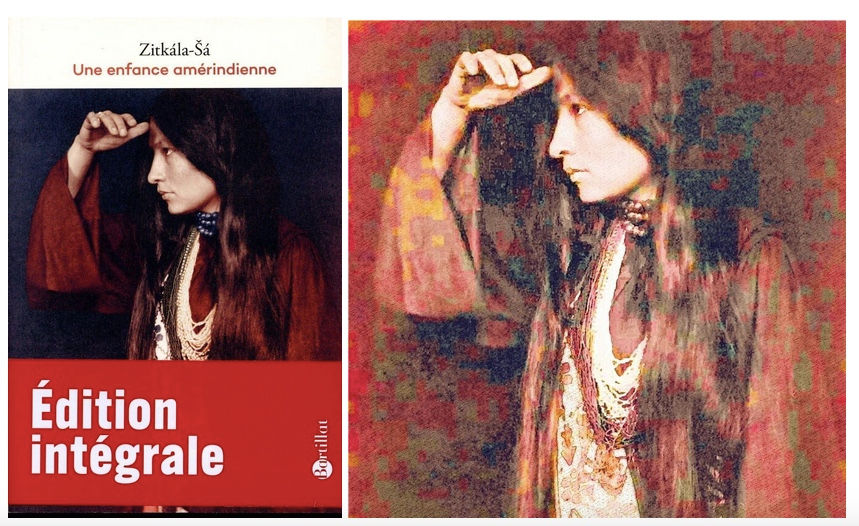Melissa Febos : L’incroyable pouvoir politique des mémoires
- Sara Durantini

- 10 juin 2025
- 7 min de lecture

Il y a un an, je me trouvais dans la ville de Turin pour présenter mon livre dédié à Annie Ernaux. Comme c’est souvent le cas, avant ou après les présentations, j’essaie de me ménager quelques heures pour moi, des moments qui n’appartiennent qu’à moi, pendant lesquels j’entre en contact avec la ville qui m’accueille. Une immersion dans une réalité différente de mon quotidien. Ce jour-là, ce qui m’est resté en mémoire, c’est la visite d’une librairie indépendante au cœur de Turin. Un mobilier d’antan, quelques lampadaires éclairant les rayonnages en bois sombre, le silence seulement interrompu par le froissement des pages d’un livre feuilleté par un jeune couple. Mon regard s’est posé sur Questa mia carne. Scrivere di sé come atto radicale (Body Work: The Radical Power of Personal Narrative). Aucune hésitation. Ce livre serait à moi. Ma prochaine lecture. Et ce fut le cas, dans les jours qui ont suivi. Et à ce livre, je suis revenue plusieurs fois, et je sais que j’y reviendrai encore : pour comprendre, pour me laisser bouleverser, pour interroger le pouvoir politique de l’écriture, surtout lorsqu’il s’agit du récit d’une femme. Depuis ce moment, je n’ai cessé de recommander ce livre et de l’emporter avec moi dans mes ateliers d’écriture, tout comme Être fille (lauréat du National Book Critics Circle Award for Criticism en 2021, consacré par le New York Times comme une grande œuvre féministe, aux côtés des livres d’Adrienne Rich et Maggie Nelson). Dans ces deux livres, avec un regard à la fois irrévérencieux et profondément original, le « je » narratif trace une cartographie du devenir femme, dessinant les passages obligés de sa génération. Être femme est un chemin de connaissance qui mène à la découverte des préjugés enfouis dans des mythes et des récits profondément ancrés dans sa propre culture. L’écriture transforme cette histoire en acte politique, en outil de résistance et de résilience : un mouvement continu vers l’intérieur et vers l’autre.
J’ai eu le plaisir d’échanger avec Melissa Febos sur ces thématiques. Dans cet entretien, l’écrivaine américaine réfléchit au sens de l’écriture en lien avec son expérience personnelle et à la manière dont cette expérience passe par le corps, en le transformant. Mais pas seulement. Febos s’interroge aussi sur l’importance de donner une voix aux récits marginalisés, de remettre en question les silences imposés, d’habiter pleinement son vécu, même lorsqu’il est fragmentaire, même lorsqu’il est douloureux. Dans ce processus d’écriture, la relation au concept de vérité et de mémoire est centrale. D’ailleurs, comme elle l’écrit elle-même dans Être fille : « Quelle que soit la rivière dont nous buvons, l’oubli n’efface pas notre passé. Il ne fait que cacher les épaves que nous emportons dans la vie suivante ». Des mots qui rappellent, ce n’est pas un hasard, Mémoire de fille d’Annie Ernaux.
SD : J’aimerais commencer par Girlhood. Dans ces pages, vous écrivez les histoires du corps, du sang, de la chair — même les plus intimes, les plus fragiles, celles qui sont souvent réduites au silence. Cela m’a rappelé Michelle Perrot lorsqu’elle parle de la nécessité de sortir les femmes de l’ombre et de les encourager à raconter leurs histoires. À quel moment avez-vous compris que votre corps deviendrait à la fois l’outil et le contenu de votre écriture ? Et y a-t-il eu un moment où vous avez senti que l’acte d’écrire n’était pas seulement un moyen de rompre le silence autour de votre propre histoire, mais aussi de donner une voix à tant d’autres femmes ?
MF : J’ai commencé comme poétesse, puis je suis devenue romancière à l’âge adulte. Au milieu de ma vingtaine, mon histoire personnelle a simplement exigé d’être racontée. J’avais étouffé la vérité de mon expérience vécue, de mon expérience corporelle, et elle a fini par s’imposer à moi. L’écriture avait toujours été pour moi un lieu privé, un espace où je pouvais tester l’indicible, me confronter à moi-même et mettre des mots sur des sujets que je ne pouvais pas aborder avec les autres. Je crois donc que mon psychisme a reconnu cette échappatoire et s’en est emparé.
Après avoir écrit mon premier livre, mes mémoires, je pensais que ce serait le seul. Puis je l’ai publié, et j’ai vécu cette expérience profonde de me sentir reliée, à travers mon récit, à des milliers d’autres femmes ayant vécu des expériences similaires, des expériences dans lesquelles nous nous étions toutes senties isolées. J’ai alors compris l’immense pouvoir politique des mémoires. Et pourtant, je n’imaginais pas en écrire un autre. Mais, comme auparavant, mon histoire s’est à nouveau imposée à moi comme la meilleure que j’avais à raconter, celle que je devais écrire, alors j’ai écouté. Et j’ai continué d’écouter.
Body Work est un véritable manifeste, un texte qui encourage à écrire non pas pour plaire, mais pour survivre. L’écriture comme geste politique, comme acte de réappropriation, comme tentative radicale d’habiter sa propre histoire. Quand et comment est né ce livre ?
J’enseigne l’écriture créative, et en particulier la non-fiction créative, depuis presque vingt ans. Au fil des années, j’ai vu les étudiant·e·s affronter sans cesse les mêmes inhibitions. En particulier mes étudiant·e·s issu·e·s de minorités (femmes, personnes racisées, immigrant·e·s, et auteur·rice·s queer) et l’une des inhibitions les plus courantes est l’idée que leurs histoires ne valent pas la peine d’être racontées. Qu’ils ou elles sont égoïstes rien que d’envisager de les écrire. Il s’agit de biais intériorisés que j’ai moi-même subis, et que je n’ai reconnus qu’au moment où j’ai publié mes premières mémoires. J’ai passé des années à inviter mes étudiant·e·s à interroger ces présupposés, et à se demander : à qui profite leur silence ? — une question que j’ai apprise à poser grâce à des écrivaines féministes comme Audre Lorde.
J’ai entendu tant d’étudiant·e·s et d’écrivain·e·s parler de manière condescendante des mémoires et de l’écriture personnelle que j’ai voulu partager mes réflexions sur l’origine de ces préjugés avec un public plus large. J’ai donc écrit Body Work comme un moyen d’inscrire les mémoires dans le canon des formes artistiques intellectuelles et psychologiques profondes, ainsi que des pratiques spirituelles. Je voulais offrir du courage à toutes celles et ceux qui doutent de ce pouvoir, qui doutent du pouvoir de leur propre histoire.
Girlhood et Body Work décrivent le corps comme une archive d’expériences, de désirs, de blessures et de révélations. Que signifie pour vous écrire à partir du corps et avec le corps ? Ce type d’écriture permet-il de faire apparaître une vérité indéniable sur la page ?
Nos corps sont les portails de toute expérience : intellectuelle, sensible, politique — tout passe par là. Chaque œuvre d’écriture, chaque œuvre d’art, passe par le canal du corps. Certain·e·s créateur·rice·s en ont conscience explicitement, d’autres non, mais cela reste toujours vrai. C’est peut-être la seule vérité indéniable. Tant de formes de vérité sont subjectives, le fait d’écrire des mémoires me l’a clairement appris. Il existe autant de versions vraies d’une histoire qu’il y avait de personnes présentes, et ces vérités peuvent se contredire entre elles.
Étroitement lié à ce discours sur la vérité, il y a celui de la mémoire. Dans ton écriture, la mémoire n’est jamais linéaire. C’est une matière vivante, elle palpite, elle se transforme au fur et à mesure qu’on l’observe. C’est une forme de mémoire qui m’a rappelé la mémoire matérielle d’Annie Ernaux. Comment travailles-tu avec la mémoire dans ton processus d’écriture ? Et que se passe-t-il lorsque la mémoire entre en interaction avec la structure narrative ?
La mémoire interagit toujours avec la structure narrative dans mon travail. Je fais beaucoup de recherches pour connaître mes propres souvenirs, et pour les interroger. J’écris dans un journal, je mène des entretiens, je parcours mes archives numériques personnelles, je revisite des chansons et des textes que j’aime. Et j’accepte que la mémoire puisse être impressionniste, qu’elle s’attache plus fermement à la vérité émotionnelle qu’aux faits concrets. Utiliser une structure narrative signifie que je dois laisser beaucoup de choses de côté. Cela signifie aussi que je dois gérer les trous de mémoire, les combler par des suppositions ou d’autres sources, ou écrire autour d’eux. Parfois, ce sont justement les lacunes de la mémoire qui sont la partie la plus intéressante d’une histoire.
Dans Girlhood, tu écris : « Quelle que soit la rivière dont nous buvons, l’oubli n’efface pas notre passé. Il ne fait que cacher les épaves que nous emportons dans la vie suivante ». Une phrase qui, pour moi, fait écho à quelque chose qu’Annie Ernaux a écrit (et qui semble presque être une réponse à la tienne) : « La démonstration exemplaire que ce qui compte, ce n’est pas ce qui arrive, mais ce qu’on fait de ce qui arrive ».
Ernaux est un grand modèle pour moi, et j’adore cette citation, je pense que c’est une vérité à laquelle beaucoup de gens sont confrontés au cours de leur vie, en particulier ceux et celles qui cherchent à écrire ou à connaître une version plus authentique de leur propre histoire. Les mémorialistes, peut-être de manière ironique, sont souvent ceux qui sont le plus disposés à anéantir leurs propres fantasmes. Nous comprenons qu’un fantasme n’est utile que pour nous-mêmes, et seulement de façon temporaire. La vérité, elle, est un service rendu à toutes et à tous.
Autobiographie, autofiction, mémoires : ce sont des termes souvent confondus ou utilisés de manière interchangeable. Quel est ton rapport à ces étiquettes ? De quelle manière penses-tu traverser, ou peut-être briser, les frontières entre fiction et vérité ?
Je pense que le genre n’est qu’une définition catégorielle inventée pour savoir où ranger les livres dans les librairies. Il ne découle pas des caractéristiques essentielles de l’art. À mes yeux, toute œuvre littéraire franchit les seuils du genre, que l’on en soit conscient·e ou non. Les mémoires ne sont pas entièrement non-fictionnelles non plus, mais une forme créative de narration qui mêle expérience et imagination, tout comme le font fiction et mémoire.
Il y a beaucoup de courage dans ton écriture, une nudité émotionnelle qui peut désarmer. Ressens-tu parfois le poids d’une telle exposition ?
Je ne me sens émotionnellement nue qu’au moment du premier jet. Ensuite, je passe des années à faire connaissance avec le texte, à travailler l’esthétique de sa présentation. Ce qui paraît brut ou vulnérable au lecteur est en réalité un sujet avec lequel j’ai cultivé une relation pendant des années. Je suis devenue amie avec lui.
Quels livres ont fait partie de ton éveil, comme dirait Susan Sontag ?
Beaucoup de Ernaux, sans aucun doute. Les essais de Sontag, ainsi que ceux de Baldwin, Audre Lorde, Adrienne Rich. Pour être honnête, j’ai toujours surtout lu des romans. Jeannette Winterson et Toni Morrison m’ont profondément marquée, tout comme Maggie Nelson, Zadie Smith, Deborah Levy et d’autres écrivain·e·s contemporain·e·s.
The Dry Season: A Memoir of Pleasure in a Year Without Sex est son dernier livre, un récit authentique puisant dans un chapitre de sa vie où elle choisit délibérément de ne pas définir son Être à travers les passions, mais de savourer les délices de la solitude, l’émotion de vivre selon ses propres termes. En mettant ses expériences en dialogue avec celles des femmes historiques (de la mystique du XIe siècle Hildegarde de Bingen en passant par Virginia Woolf et Octavia Butler), Febos inscrit son récit dans une généalogie très personnelle, faite de femmes qui ont poursuivi sans remords leurs ambitions et leurs idéaux.

Melissa Febos, The Dry Season: A Memoir of Pleasure in a Year Without Sex, Knopf, juin 2025, 288 pages, $29.00.