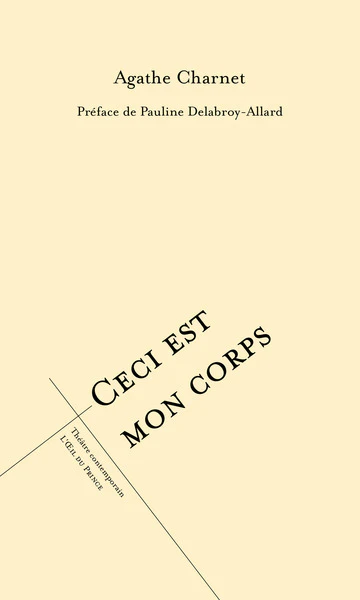Écrire une nouvelle histoire du corps féminin en scène
- Delphine Edy

- 16 déc. 2025
- 12 min de lecture

vous verrez mon corps actuel
voler en éclats
et se ramasser
sous dix mille aspects
notoires
un corps neuf[1]
Il y a quelques jours je proposais une analyse critique d’Un jour sans vent (Une Orestie) de Céleste Germe, dans laquelle la metteuse en scène nous offre une contre-plongée incandescente à la tragédie originelle et crée un dispositif théâtral poétique pour les voix trop longtemps silenciées des femmes. Et force est de constater que le vent s’est levé en effet, depuis quelques temps, sur les plateaux de théâtre. Il se passe quelque chose de décisif pour le corps des femmes, pour l’histoire des corps féminins. Comme si le théâtre, ou plus exactement, comme si des metteuses en scène avaient décidé d’offrir une prolongation de la pensée foucaldienne, une nouvelle facette de la mosaïque des corps faisant histoire. Comme si ces « corps-cibles », en devenant « corps-chair » étaient à même de se révolter et de devenir des « corps de vérité »[2].
Retours sur trois spectacles vus en cette fin d’année 2025 : Ceci est mon corps d’Agathe Charnet, The Brotherhood de Carolina Bianchi et Médusée de Léna Bokobza-Brunet, qui ont ceci de commun que leur dramaturgie a à voir avec une véritable « boule à facettes », capable de diffracter la lumière gagnée via le combat avec l’écriture.
*****
Ceci est mon corps (texte et mise en scène Agathe Charnet)
Créé en 2022 au Théâtre de La Halle O Grains de Bayeux par la compagnie La Vie Grande, Ceci est mon corps est depuis en tournée : de festivals en théâtres[3], il parcourt la France, et c’est, enfin, à L’Étoile du Nord (Paris) que je l’ai découvert fin novembre. Ceci est mon corps est un spectacle autofictionnel qui prend appui sur le corps d’une jeune femme d’aujourd’hui qui devient un corps lesbien. Le texte, publié aux Éditions l’Œil du Prince, pour lequel l’autrice a été lauréate de la Bourse Beaumarchais-SACD en 2020 et de l’aide à la création Artcéna 2021, se fonde à la fois sur une enquête dans la mémoire intime, mais également sur une trentaine d’entretiens avec des femmes autour de leur rapport au corps, ainsi que sur des lectures fortes que sont la littérature lesbienne, queer, féministe, notamment celle de Monique Wittig. De cette hybridité naît une écriture éminemment personnelle, un véritable récit de soi, un texte d’ailleurs bien plus long que les extraits qu’on en entend lors de la performance.
Pourtant, ce geste théâtral déborde à l’évidence de l’intime pour venir s’inscrire dans la salle, dans les corps du public, avec un je ne sais quoi d’une grande messe queer. La voix de l’autrice se démultiplie, comme le pain et le vin en leur temps : deux magnifiques interprètes portent son texte au plateau, Virgile–L. Leclerc et Lillah Vial, mais, en choisissant aussi de faire entendre au début du spectacle toutes les voix du public (accueilli comme s’il venait pour une répétition à la chorale), la metteuse en scène nous engage collectivement dans le récit qui s’engage. Ce qui se raconte est aussi une histoire plus vaste : celle des corps féminins empêchés, invisibilisés, meurtris, mais déterminés à avancer.

*****
The Brotherhood (conception, textes et mise en scène Carolina Bianchi)
Le deuxième opus de la Trilogie des chiennes (Trilogie Cadela Força) a été créé le 9 mai 2025 au KVS (Bruxelles) dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts et connait depuis une large tournée européenne. C’est dans ce cadre qu’il s’est installé à La Villette pour le Festival d’Automne, où la metteuse en scène brésilienne avait présenté en 2024 le premier opus de cette trilogie, La Mariée et Bonne nuit Cendrillon. Traduit du portugais par Thomas Resendes, le texte a été publié aux Solitaires intempestifs en septembre 2025.
Au cours d’un spectacle tentaculaire de 3h40, l’artiste – avec la compagnie Cara de Cavalo – interroge le concept de « fraternité » au sens de « solidarité masculine ». Cette notion, croisée lors de sa recherche préliminaire, au moment de la conception du premier opus, se voit ici convoquée explicitement via les plus de 500 pages qu’elle exhibe sur le plateau. En lisant l’anthropologue argentine Rita Segato, pour qui les meurtres de femmes de Ciudad Juárez (dont Roberto Bolaño s’empare dans son roman 2666 qu’on a pu découvrir dans la mise en scène de Julien Gosselin – création 2016) sont une répercussion de cette solidarité masculine, la metteuse en scène réalise qu’il s’agit d’« un système qui se protège lui-même, ce qui le rend très fort, presque impénétrable et dont le viol et le meurtre sont le langage[4] ».
Partant de ce constat, Carolina Bianchi déploie les moyens du théâtre pour comprendre les mécanismes qui dépassent la seule confrérie des hommes. Les femmes aussi sont associées à cette réflexion, jamais naïve mais jamais dogmatique non plus, en soulignant combien leur rapport aux œuvres et au milieu artistique est complexe et pose question. L’artiste convoque de multiples références culturelles pour écrire : Le Viol d’Hippodamie par Rubens, La Mouette de Tchekhov qui déjà en son temps interrogeait le rapport morbide au génie, Le Purgatoire de Dante dont le poète et le guide trouvent un écho dans le duo Carolina Bianchi et The Master (voix masculine enregistrée), le travail de la dramaturge Sarah Kane dont on connaît le rapport à la puissance destructrice, Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë livre qui, loin d’être une romance, ne parle que de cruauté...
Surtout, à la différence de son précédent spectacle où seule la performance était le vecteur de sa recherche, elle convoque ici différentes formes de parole pour mieux confronter le théâtre à ses possibles dans une méta-analyse savamment orchestrée. Bien sûr, elle ne renonce pas complètement à la dimension scandaleuse – notamment dans la scène où elle se masturbe avec un godemichet en écoutant un enregistrement de la voix de Tadeusz Kantor – mais elle va beaucoup plus loin en hybridant les gestes : adresses public, entretien avec un metteur en scène adulé (possible double fictif de Thomas Ostermeier[5]), fausse soutenance de thèse, récit de soi… Le théâtre devient le lieu qui permet de confronter ledit théâtre et d’interroger sa capacité et sa légitimité à dire quelque chose de juste sur le monde théâtral institutionnel, car on se souvient que c’est précisément dans ce milieu que l’artiste a été violée, ce qu’elle rappelle au tout début du spectacle lorsqu’un homme s’adresse à un nouveau-né qu’il tient dans les bras en lui racontant sa vie par anticipation :
Et tu feras de l’art, ta confiance sera égale à tes tourments. Et tu auras accès à tout le savoir nécessaire pour créer des chefs-d’œuvre. Et tes frères fraternels t’accueilleront avec les meilleures intentions du monde. Et alors, vous célébrerez ensemble ce grand triomphe d’être vous-mêmes. Et au cours de cette fête, vous déciderez de droguer une femme, une actrice. Et alors elle s’endormira[6].
En faisant émerger sur la scène la violence masculine inhérente à la culture théâtrale – pensée pour le mouvement #MeTooThéâtre – Carolina Bianchi élève cet art et impose sa marque de fabrique : faire de la traversée violente de l’obscurité le prérequis indispensable à toute possible libération du corps.

*****
Médusée (texte et mise en scène Léna Bokobza-Brunet)
Créé il y a tout juste quelques jours à Théâtre Ouvert, Centre National des Dramaturgies Contemporaines, le spectacle autofictionnel de Léna Bokobza-Brunet vient questionner à sa manière des millénaires de patriarcat et de violence sexuelle. Elle se lance dans une enquête à la fois intime et culturelle pour mieux reconstituer le parcours qui l’a amenée à considérer comme « normal » et « possible », ce qui ne l’est pas. En scrutant les scénarios de films, séries et romans, elle montre comment les œuvres fictionnelles façonnent nos comportements et nos désirs, car, oui, Chloé Thibaud l’a d’ailleurs magistralement montré dans son essai paru en 2024, il est possible de « Désirer la violence », même sexiste et sexuelle, « sous le vernis de nos divertissements préférés ».
Dans ce spectacle, Léna Bokobza-Brunet convoque sa propre histoire qu’elle tisse à celle, mythologique, Léna Bokobza-Brunet convoque sa propre histoire qu’elle tisse à celle, mythologique, de la Gorgone Méduse, dans une version revisitée par l’autrice Béatrice Bienville[7] qui interroge l’identité du monstre à nouveaux frais : et si la violence de Méduse qui transforme en pierre tous ceux qui la regardent, n’était en fait que le résultat de la violence subie ? Car voilà, lorsque les hommes voient dans ses yeux la violence qu’ils lui ont infligée, cela n’est tout simplement pas supportable. La solidarité masculine s’en trouve pétrifiée et l’histoire retournée : ces yeux deviennent « deux boules à facettes qui difractent la violence et la transforment en lumière », entend-on sur le plateau.
Pour appréhender cette histoire, l’artiste convoque ses sœurs Gorgone, Pauline Chagne et Léa Moreau. À trois voix, elles donnent corps au récit qui entremêle astucieusement le mythe de Méduse revisité, le récit de soi et les voix d’autres femmes qui viennent se tisser aux leurs, mais, surtout, elles le font dans un geste éminemment singulier qui articule esthétique du cabaret avec force de paillettes et de couleurs, concert « pop » et performance.

*****
Si ces trois gestes artistiques cultivent une relation singulière au théâtre et convoquent des récits différents, il n’en reste pas moins qu’il y a dans la répétition du même, quelque chose de profondément troublant. Comme déjà dans la dernière création de Das Plateau, Un jour sans vent (Une Orestie), nous nous trouvons placés sous le statut de témoins assistés. Nous étions là, nous avons entendu et vu, finis les angles morts. Nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. Mais qu’on ne se méprenne pas, dans ces créations, il ne s’agit pas de pur militantisme, le théâtre, en tant que « la plus ancienne forme d’art de l’humanité » (Milo Rau), est assigné à faire entendre les armes dont il dispose pour changer le monde.
Agathe Charnet, Carolina Bianchi et Léna Bokobza-Brunet ont ceci de commun qu’elles écrivent leurs spectacles en s’emparant des méthodes des sciences humaines et sociales (travail d’enquête, pratique de l’entretien, nombreuses lectures théoriques), tout en laissant les forces du théâtre agir, de sorte que l’art théâtral transfigure le militantisme : les batailles à mener aujourd’hui deviennent autant de politiques des corps à mettre en œuvre.
En faisant le récit au plateau de corps féminins en lutte pour leur existence pleine et entière, ces metteuses en scène proposent un autre regard pour penser la vérité de ces corps et montrer « comment la vérité prend corps dans les corps, mais comment aussi les corps la falsifient en voulant la vérifier, la contestent en voulant l’incarner, la démultiplient en voulant la vérifier ». Ce qui les intéresse toutes trois, « ce n’est ni le corps comme objet d’un discours de vérité, ni le corps comme sujet originaire d’un rapport vrai au monde. C’est un corps travaillé, traversé, compliqué par la vérité »[8], ainsi que l’écrit Arianna Sforzini à propos de Michel Foucault.
Comment ça commence ?
Autrement dit, quand est-ce que le corps-théâtre commence ? C’est la question que pose chacune d’elles au début de leur spectacle.
Dans The Brotherhood, le récit ne parvient pas à commencer, à moins qu’il ne cesse de recommencer. Trois prologues – le mot s’affiche systématiquement sur l’écran en fond de scène – se succèdent : la langue de Dante, celle d’un jeune père parlant tout bas à son nourrisson, disant les mots des hommes pour les hommes, puis les mots de Tchekhov dans La Mouette que la metteuse en scène prend elle-même en charge. Face à ces trois tentatives de début, elle ne faillit pas : peut-être faut-il d’ailleurs tous les convoquer en même temps ? Carolina Bianchi définit le terrain depuis lequel elle parle, depuis lequel elle va maintenant parler, puisqu’elle s’est réveillée du premier opus de la trilogie. Ce terrain, c’est un dialogue, une véritable conversation théâtrale, capable de mettre en exergue contradictions et convergences, paradoxes tragiques et questionnements existentiels, de tracer un chemin permettant de quitter définitivement l’Enfer pour traverser le Purgatoire et – peut-être dans le troisième opus, atteindre le Paradis… Le théâtre est son terrain de jeu : qu’elle convoque textes du passé, images, paysage sonore ou la grande machinerie du théâtre, c’est par le théâtre seul qu’elle peut espérer avancer sur le chemin qu’elle partage avec son corps violenté. Le corps et le théâtre apparaissent finalement comme les deux faces du même pour cette performeuse qui sait qu’au théâtre, soit on joue sa vie, soit on le quitte. En cela, elle est de la même trempe que la performeuse espagnole Angélica Liddell.
Chez Agathe Charnet, le commencement est inscrit dans la question inaugurale du texte : « Par quoi ça a commencé ? »
Peut-être que, dès l’origine
`Dès la matrice
C’était déjà là.
Car ça débute peut-être par des mots, peut-être oui
Qu’à mon commencement était leur verbe[9].
Un verbe perçu par un petit corps encore enfermé dans celui de sa mère, qui devient le discours, celui qu’on ne remet pas en question, même si ce « Je » est « entre deux », ce corps toujours « tiraillé, à la lisière du reconnaissable »[10]. Il lui faudra traverser les épreuves de l’enfance et de l’adolescence, relever des défis qu’il s’impose pour être comme les autres, souffrir pour être belle, souffrir pour ne pas décevoir l’homme, jusqu’aux violences de l’emprise qui s’exprime dans « Ton corps est à moi[11] ».
Cette histoire c’est fou
C’est comme une boule à facettes
Plus on la tourne
Plus il y a de reflets de soi-même diffractés dans les petits miroirs déformants […]
Plus ça avance et plus je me dis que
Cette histoire
C’est fou
C’est qu’une question de perspective[12]
Long est le chemin pour arriver à soi, et c’est ce chemin que la performance trace, de l’obscurité à la lumière, à la fois visuelles et sonores (grâce au talent de Virgile–L. Leclerc et Lillah Vial et au travail musical de Karine Dumont) : de la falsification/contestation, à l’explosion, lorsque la vérité de son propre corps peut enfin se dire. Plus de peur, plus de sidération : le corps a trouvé sa place, ses sœurs, son amour. Et il n’a plus qu’une idée en tête, « protéger nos corps[13] » de femmes.
Dans Médusée, la question du commencement s’incarne dans une esthétique singulière de la listequ’elle adresse au public, le plus souvent au seuil du plateau, au bord de l’histoire qui naît. Il faut faire la liste de toutes les références culturelles qui constituent son être, faire aussi la liste de ce qui la définit comme femme – une très longue liste qui se termine par l’expression « femme-méduse ». Comme s’il fallait toujours partir à la recherche de l’origine, à ce qu’il y avait avant l’existence de toute chose, avant sa propre existence peut-être même. À moins que l’origine ne soit le moment où elle a été mordue pour la première fois par un serpent ? « Je ne sais pas si c’est là que ça a commencé ». Alors, pour se libérer de toutes les violences subies, elle tente de se réinitialiser, mais une voix métallique retentit : « la réinitialisation a échoué ». Pas de nouveau commencement possible. Pas de retour au point initial. Il va falloir continuer à dresser des listes, à raconter donc, à mettre son corps à l’épreuve, à le laisser être travaillé par l’expérience du plateau, traversépar les ressentis et les émotions, à retrouver une forme d’agentivité.
Pour Léna Bokobza-Brunet, la musique « pop » est une alliée de choix dans cette traversée. Faire entendre ces voix féminines qui l’ont vue grandir, c’est trouver « un langage commun » dit-elle, pour mieux se confronter au monde. « Ne pas omettre les paroles qui font mal ou qui dérangent, [ne pas] prendre de gants, [le faire] avec honnêteté et paillettes »[14]. Les paillettes, comme les lettres d’apparat que l’on disposait au début des chapitres des manuscrits, incarnent l’ébauche d’un autre possible du corps. Elles l’aident à retrouver son rythme, son souffle, son énergie : et d’une chorégraphie à une autre, d’une chanson à une autre, ce corps reprend vie pour raconter lui aussi sa version de l’histoire collective, « ajouter [s]a voix à celles des autres, mettre un poids de plus dans la balance ». Lorsqu’elle sort enfin de sa grotte, c’est la scène de théâtre qu’elle quitte, c’est vers le monde qu’elle court, et, oui, il n’en faut pas douter, elle va « l’éblouir ».
*****
Dans cette nouvelle histoire du corps féminin qui s’écrit aujourd’hui sur les plateaux de théâtre, le militantisme est assurément présent – comment pourrait-il en être autrement ? – mais les choix esthétiques forts de ces artistes femmes permettent de dépasser la théorie froide, la colère et la sidération : elles nous proposent de nouvelles histoires, susceptibles de nous offrir une ascension collective, une joie à construire pas à pas, une nouvelle tendresse pour soi-même et pour les autres corps, une Puissance de la douceur dirait Anne Dufourmantelle, capables de transformer nos souffrances en une force puissante et véritablement fraternELLE.
Notes
[1] Antonin Artaud, extrait de « Post-scriptum », Le Théâtre de la cruauté, dans Œuvres complètes, tome XIII, Paris, Gallimard, 1974, p. 118
[2] La réflexion qui sous-tend cet article doit beaucoup au très beau livre d’Arianna Sforzini, Michel Foucault : une pensée du corps, Paris, PUF, 2014, à (re)lire et offrir en cette fin d’année !
[4] Carolina Bianchi, « Entretien », dans Programme de salle, La Villette, Festival d’Automne édition 2025, p. 2.
[5] Les indices glissés dans l’entretien fictif sont nombreux quand on connaît le metteur en scène mais, compte tenu de ce qui est dit sur son rapport aux comédiennes et, plus généralement, sur son rapport au pouvoir, ainsi que de la fin tragique qui lui est réservée dans le spectacle, on voudrait se tromper…
[6] Carolina Bianchi, The Brotherhood, Trilogie des chiennes, 2, Besançon, Les Solitaires intempestifs, trad. T. Resendes, 2025, p. 15.
[7] Béatrice Bienville, La véritable histoire de la gorgone Méduse : Ou comment tuer un visage, Angers, éditions Le Quai, 2022.
[8] Arianna Sforzini, Michel Foucault : une pensée du corps, Paris, PUF, 2014, p.9.
[9] Agathe Charnet, Ceci est mon corps, Paris, éd. L’Œil du prince, 2022, p. 17.
[10] Ibid., p 31.
[11] Ibid., p 95.
[12] Ibid., p 97.
[13] Ibid., p 126.