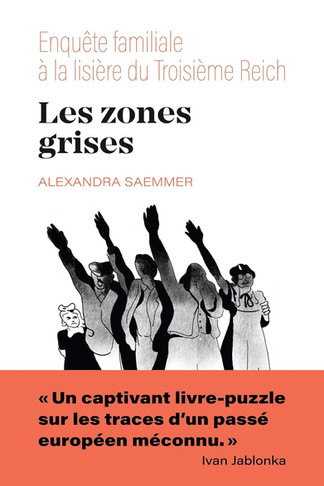Une rentrée politique des mères
- Simona Crippa & Johan Faerber

- 31 août 2025
- 13 min de lecture

Comment se saisir de cette rentrée littéraire qui, depuis bientôt quelques jours, déferle en librairie ? Peut-on dessiner, comme Collateral a pris l'habitude de le faire, des lignes critiques qui permettent de saisir ces 484 romans qui paraissent en un temps resserré sur quelques semaines qui seront moralement couronnées par l'attribution des grands prix d'automne, avant peut-être que la rentrée politique ne nous avale toutes et tous ? Assurément, cette rentrée se place, sans discussion possible et avec une rare évidence sous l’égide des figures maternelles qui occupent le devant de la scène. Il y a même plus de mères dans les romans de la rentrée qu'à la sortie des écoles.
Cependant, d'emblée, si on ne peut que s'accorder sur ce postulat, force est de reconnaître que les mères qui s'y donnent à lire et à voir ne ressortissent pas aux attendus romanesques. Difficile de parler ici de récits de filiation dont ces romans de rentrée seraient l'inévitable sinon le fatal prolongement. Difficile aussi de parler des mères avec une grille psychologisante saupoudrée, pour faire moderne, de tache aveugle à la Blanchot où la mère s'imposerait comme un mystère insondable. Car ce que cette rentrée littéraire signale, de manière massive et indiscutable, c'est, raisonné et unanime, le déploiement d'une politique des mères : comme si se dévoilaient ce qu'il faudrait nommer des récits de matriarcalisation.

De Paul Gasnier à Pierre Boisson en passant par Laurent Mauvignier ou encore Nassera Tamer, la rentrée littéraire présente un rare visage cohérent où s'établit une poétique du récit de matriarcalisation qui indique, avec force et mesure, la place politique des mères : comment, en somme, la mère s’y offre comme une figure qui cristallise les questionnements politiques, permet depuis elle de sonder des questions sociales comme celle du féminicide ou encore de la violence à laquelle le patriarcat les assigne ? A l'instar d'Une mère éphémère d'Emma Marsantes en 2022 qui, en livre-clef du contemporain, convoquait déjà de manière précurseure toutes les problématiques qui nous occupent aujourd'hui, les mères ouvriraient ainsi à une lecture et une écriture politique de la réalité qui dessinent autant de récits aussi forts que singuliers : déconstruire les pères comme la rentrée d'hiver l'a accompli de Clothilde Salelles ou Clara Breteau fut un premier temps auquel répond un second temps aujourd'hui : reconstruire les mères contre la violence qu'elles ont subie.
C'est tout l'objet de l'une des grandes révélations de cette rentrée, Paul Gasnier, qui avec La Collision signe l'un des récits les plus bouleversants et fermes de cette saison - sinon de ces dernières années. En des pages ramassées, d'une sobriété et d'une rare pudeur, Gasnier raconte la mort de sa mère, décédée dans un rodéo urbain, en plein Lyon. Alors qu'une dizaine d'années plus tard, Paul Gasnier, devenu journaliste, couvre les meetings de Zemmour candidat à la présidentielle, Gasnier est percuté à son tour par les diatribes racistes du champion de l'extrême droite contre les rodéos urbains : La Collision raconte alors comment le jeune homme n'est pas devenu raciste, comment s'élabore pas à pas une enquête pour savoir qui est le motard qui a tué sa mère en dressant non pas le portrait de la mère mais en restituant la puissance de ce qu'elle a inculqué à son fils restant : « Ce livre est le récit de cette collision, qui n'est ni un accident ni un meurtre. Une histoire française du début du 21e siècle, où deux destins parallèles voués à s'ignorer se sont percutés, dans un pays éclaté et malade. » Une belle et forte voix est née.
C'est aussi une formidable voix qui se donne à entendre pour la première fois dans un récit magistral également, un autre premier roman : Allô la place de Nassera Tamer, que les lecteurs de Collateral reconnaîtront pour être l'une des chroniqueuses de notre revue. En un récit d'une rare force, Nassera Tamer dresse entre non-dit et impuissance à parler le portrait troublant d'une mère conduite à une irrémédiable distance, celle de l'éloignement physique au Maroc, celle de l'éloignement social que la question de la langue vient forer. Comment parler de sa mère sans la langue maternelle même ? Comment vivre loin des siens sans même avoir les mêmes mots pour le faire comprendre ? La mère est au cœur d'un questionnement politique. De Tamer à Gasnier : l'intime est plus que jamais politique.

Un tel éclairage, loin des sentiers battus du dolorisme bourgeois dont Catherine Millet nous gratifie dans son pesant et convenu Simone Emonet où, après l'éloge du viol, elle nous monnaie désormais des larmes, se poursuit plus avant à travers, littéralement, la place dans l'histoire que les figures maternelles occupent. Wauters, dans Haute-Folie, y dessine une forte réponse par son roman généalogique spectral : sa contre-saga. Et plus largement, qu'ont fait les mères dans l'histoire ? Quelles ont été leurs places ? Pouvaient-elles occuper une place autre que celle que la violence patriarcale leur a assignée ? Existe-t-il des figures féminines autres que violentées dans le récit patriarcal et ne sont-elles pas elles-mêmes, à leur corps défendant pour certaines, des agents de cette violence ? Depuis cette strate terrible et ces ambiguïtés s'élaborent des récits de matriarcalisation, à commencer par le très beau Les Zones grises d'Alexandra Saemmer, sans doute historiquement l'un des récits les plus délicats de cette rentrée qui revient depuis les sciences sociales sur le destin des femmes de sa famille issue des Sudètes, où est questionné le rapport de sa famille au nazisme. Elle comme sa mère et sa grand-mère sont issues de « ce peuple de bourreaux ».
Car, de la mère à la fille, la mère offre à une réflexion sur la maternité : qu'est-ce qu'être mère aujourd'hui ou hier ? Comment vit la mère dans la famille qui, comme le dit Hélène Laurain, vit « un présent en expansion perpétuelle » ? Comme un écho au décidément épatant Vachette de Suzanne Duval ce printemps, Hélène Laurain offre avec Tambora une subtile et sensible réflexion sur la grossesse et la maternité, prise dans des sentiments contradictoires. C'est, puisant dans ces mêmes sentiments contraires, que Camille de Toledo offre avec Au temps de ma colère le récit sans doute le plus troublant de cette rentrée sur la figure maternelle : car une mère peut toujours en cacher une autre, une mère peut être patriarcale mais elle sera toujours sauvée par une mère matriarcale. Telle serait la leçon de ce beau récit où, plus que jamais, la place politique de la mère se pose.
Place politique mais aussi et surtout place littéraire dans la mesure où la mère ne se tait plus. Les pères veulent les tenir au secret, les jeter dans le silence et leur apprendre à ne pas écrire – ou mieux encore, les effacer du canon littéraire à travers des stratégies d’exclusion systématiques. C’est ce que démontre magistralement Joanna Russ dans son essai pionnier de 1983, Comment torpiller l’écriture des femmes, enfin traduit en français par Cécile Hermellin. Grille de lecture toujours actuelle, l’ouvrage montre combien il faut de force pour se frayer un chemin hors de la marginalité imposée par le regard masculin.
La figure maternelle est ainsi en cette rentrée une figure qui appelle avec vigueur le matrimoine. Les mères produisent des œuvres, elles écrivent, leurs récits ou leurs vers ont été rejetés dans le néant mais il appartient de leur redonner toute leur lumière. Deux récits offrent une exploration inédite et singulière des figures maternelles qui sont avant tout des figures d'écriture : Au grand jamais de Jakuta Alikavazovic n'est pas le simple portrait de la mère disparue de la romancière. Il n'est pas non plus le simple portrait de cette femme yougoslave arrivée à Paris. Il est surtout la restitution d'une œuvre poétique de l'exil. La romancière livre la poétesse.
La mère-matrimoine se loge aussi au cœur d'une des plus grandes réussites de cette rentrée : Flamme, volcan, tempête de Pierre Boisson. Une enquête passionnante sur la primo-romancière Christine Pawlowska, autrice en 1974 d'Ecarlate récit fulgurant que découvre par hasard un jour Pierre Boisson, tant séduit qu'il décide de savoir pourquoi il ne sera suivi d'aucun autre. Récit matrimoine double : celui qui permet de rééditer Écarlate (un des meilleurs romans de 2025 a donc déjà paru en 1974) et celui qui permet de comprendre dans l'existence de violence qui déchire Pawlowska la place de sa mère même, qui écrivait elle aussi. Une violence exercée sur les corps féminins que vient également pointer, avec une belle et vive puissance, l’excellent Arno Bertina dans Des obus, des prothèses et des fesses, une des grandes réussites de cette rentrée.
Mère, maternité, matriarcat, matrimoine – mais aussi, et toujours, ce désir, au sens fort du terme, de réduire les femmes et les mères au silence et à la mort avec deux autres récits clefs de cette rentrée : l’impressionnant La Nuit au coeur de Natacha Appanah et les troublants Fragments d’Hélène de Johanna Luyssen notamment sur Hélène Rytmann, assassinée par Althusser.
Car impossible dès lors, dans cette rentrée politique, de ne pas évoquer la question du féminicide en tant que logique de domination absolue sur la parole et le corps des femmes, logique qui traverse l’histoire des représentations interrogée par Ivan Jablonka dans son essai : La Culture du féminicide. Enquête ambitieuse sur les racines patriarcales de la violence faite aux femmes, le livre explore de multiples formes de représentations ayant contribué à l’édification décomplexée d’une « idéologie gynocidaire » dont notre société demeure empreinte. De l’anatomie à la peinture, des blasons à la mythologie, de la Bible à Netflix, de Boccace au sadique Marquis, de Poe à Freud et Charcot, jusqu’aux cinéastes Hitchcock, Bergman ou Laughton, Jablonka confirme la profondeur historique et culturelle de cette violence systémique contre le féminin. C’est pourquoi toutes les dix minutes une femme est tuée dans le monde. Un « continuum féminicidaire » comme l’écrit l’historienne féministe Christelle Taraud dans son ouvrage-somme Féminicide. Une histoire mondiale, peu citée hélas dans l’essai de Jablonka, qui mobilise cependant de références académiques solides comme Margot Giacinti et Jennifer Tamas ou encore Nicole Loraux dont l’essai Façons tragiques de tuer une femme (1985) révèle comment les morts des femmes dans la tragédie grecque exposent déjà les dynamiques de pouvoir à l’œuvre dans la construction sociale du féminin.
On pourrait lire La Culture du féminicide à travers la grille de Joanna Russ. L’essai reste en effet marqué par le regard masculin : attentif mais extérieur, critique mais non féminin ni féministe. C’est cette limite, autant que sa force, qui confère sans doute à l’ouvrage son importance dans le débat public.
Mère, maternité, matriarcat, matrimoine : autant de questions enfin qui traversent, structurent et font de La Maison vide de Laurent Mauvignier l'une des plus éclatantes et émouvantes réussites de cette rentrée - voire de ces dernières années. Mauvignier signe ici le roman que chacun fantasme d'écrire sur sa famille : il accomplit la rare et folle réussite de proposer un roman à l'état pur sur un matériau autobiographique comme toujours impur : raconter en revenant dans la maison de famille qui est la sienne le destin maudit et tu de sa grand-mère, celui de son arrière-grand-mère Marie-Ernestine à La Bassée. Dans une écriture d'une sobriété tenue, qui déploie comme on lit peu une force psychologique où chaque scène représente un éclat de caractère des personnages, Mauvignier présente à travers ses aïeules ces femmes contraintes à ne pas être par la société de leur époque – mais aussi par leur récit.
C'est une formidable odyssée de poétique du récit : comment raconter par exemple le destin de Marie-Ernestine dans les années 1890 sans être soi-même empreint par le récit dominant d'alors : le naturalisme de Zola ? Comment raconter la Première ou la Seconde Guerre mondiale sans soi-même rapporter un récit formaté par les récits d'alors ? On comprend que l'entreprise est politiquement et littérairement passionnante. Un roman qui refuse de se soumettre lui-même à l'enquête, un roman familial sans photo. Sans archives. Sans documents aucun. « Je fais du roman » dit Mauvignier dans une déclaration qui annonce sans doute un changement de paradigme dans le champ littéraire structuré jusqu'ici par le souci de l'enquête.

****
Encore un mot avant de conclure provisoirement cet édito prospectif sur cette rentrée politique des mères de famille avec un récit extrêmement problématique qui s'inscrit dans les mêmes questionnements mais depuis un point de vue pour le moins sujet à caution – ou en tout cas en proie à de sévères doutes. Car, désormais, à chaque rentrée, certains livres procèdent des mêmes interrogations mais afin d'offrir des réponses qui se tiennent comme autant de questions troublantes. Si janvier a été marqué par l'antiféminisme de Constantin Alexandrakis, ce printemps par le patriarcal Toronto d'Elisabeth Benoit, que penser du très curieux pour ne pas dire poisseux Kolkhoze d'Emmanuel Carrère ?
Que penser, effectivement, de ce nouveau récit si attendu et déjà si célébré d'Emmanuel Carrère autour de la figure de sa mère, Hélène Carrère d'Encausse historienne de renom de l'Union soviétique notamment, secrétaire perpétuelle de l'Académie française et figure marquée par des idées souvent très proches de l'extrême droite ? Que dire, tout d'abord, sinon que le récit avance comme s'il avait oublié d'écrire en ne brassant volontairement - comme il le revendique - que des « clichés » ? Que dire sinon que ce récit se résume à une paresseuse enquête qui dérive vers une énumération généalogique de la famille émigrée russe de l'auteur dont l'histoire demeure toujours contée en surface ? Que dire de cette absence d'écriture sinon qu'elle ouvre à un double problème politique : si Carrère prend si peu soin de raconter c'est que le roman est avant tout celui d'un nepobaby, qui fait de la gloire maternelle une manière de rente médiatique sans vergogne ?
A ce premier problème politique vient s'ajouter un second qui touche encore à l'écriture : rien n'est décrit, rien n'est présenté, rien n'est caractérisé car, de manière doucement réactionnaire, Kolkhoze qui n'a donc de révolutionnaire que son titre, fait de la figure maternelle un passe-droit politique où Carrère écrit comme sous l'Ancien Régime : pas de portrait, que des prosopographies, c'est-à-dire des déclinaisons de titres et de statuts sociaux en lieu et place de toute présentation de personnage ? Ce n'est pas une autobiographie mais une mythographie où Carrère s'invente et se fantasme une fois encore Grand écrivain.

Peut-être plus inquiétant encore : la place de l'extrême droite dans Kolkhoze. La famille Carrère, on le sait depuis Un roman russe, est entourée du grand-père jusqu'aux amitiés de la mère par des figures fascistes comme Maurice Bardèche notamment. Mais à quel jeu joue Emmanuel Carrère ici ? On est en droit de sérieusement se poser la question quand Carrère vient à évoquer ces figures fascistes. Le jeu devient soudainement et étonnamment très trouble. Comment comprendre ainsi les formules euphémisantes égrenées sur un ton badin dont Carrère use pour évoquer la bascule fasciste de Brasillach en disant « les choses se gâtent » comme s'il s'agissait de frivolités ? Comment comprendre encore, après avoir loué le « furieux génie » de Céline, que Carrère relativise la condamnation à mort de Brasillach de la sorte : « on peut dire qu'il a payé pour les autres. Grande dignité dans son procès : comme s'il avait dessoûlé » ? “Dessoûlé” : comme si le fascisme était une simple cuite. Ou pire : une belle ivresse, terme on le sait hautement connoté poétiquement.
Que dire encore de cette présentation de Raoul Girardet dont Carrère dit : « un ancien résistant, torturé par la Milice, mais aussi un ancien de l'OAS – ces deux engagements, l'un glorieux, l'autre discrédité, procédant du même patriotisme viscéral » ? Curieuse formule que celle d' « engagement », terme extrêmement valorisant. Ou plus curieux encore ici l'usage du terme « discrédité » comme s'il avait été injustement ou comme si on pouvait porter du crédit et de l'estime à une organisation fasciste comme l'OAS. Et que penser également du portrait de Maurice Bardèche qui se construit autour d'une large citation de ce personnage louant la beauté des chants fascistes sans que Carrère prenne même la peine un seul instant d'en commenter la teneur ? Pourquoi faire suivre cette citation de cette remarque sur un ouvrage de Bardèche : « Ma mère trouvait charmant Suzanne et le taudis. C'est vrai, à certains égards c'est charmant » ? Voilà qui n'en finit pas d'être curieux, plus encore aussi quand, outre les citations qui, sans discours, semblent être davantage diffusées que commentées pour l'exemple ? Que se passe-t-il alors ? Est-ce que Carrère joue d'un supposé discours indirect libre où il reprendrait sans guillemets les commentaires de sa mère sur ses amis fascistes ? Voilà qui maintient plus qu'une ambiguïté : tout parait jouer ici d'une confusion.
Dès lors que penser de ces formules étonnantes comme « Cet Henri Poulain si amusant était une des pires crapules de Je suis partout » ? Pourquoi « si amusant » est-il mis absolument sur le même plan que « une des pires crapules » ? Peut-on parler d'une quelconque dénonciation du fascisme quand Carrère prend la peine de ne pas écrire par exemple : « Derrière cet Henri Poulain si amusant se cachait en vérité une des pires crapules de Je suis partout » ? Les formules ne sont définitivement pas les mêmes, on le mesure sans peine. Peut-être parce que Carrère met tout sur le même plan de manière très inquiétante au nom d'un principe de théoricien russe de la littérature qu'il cite, Mikhaïl Bakhtine, le dialogisme : « cette façon de déployer des voix contradictoires sans laisser à personne le privilège, fasciste ou kitsch, du dernier mot. » Nous voilà prévenus, tout est équivalent car Carrère veut rester neutre.
Or la neutralité, on le sait depuis longtemps, n'existe pas en littérature : ne pas commenter une citation fasciste exprime un point de vue par le silence. Mettre fascisme et antifascisme sur le même plan dit quelque chose. Le dialogisme est une mauvaise mère car n'y a-t-il pas ici un terrible double bind ? N'est-on pas plutôt en droit de parler d'un confusionnisme ? Mais à qui ce confusionnisme profite-t-il quand, au milieu de larges passages de récits fascistes jamais mis à distance, les antifascistes sont folklorisés par des formules ridiculisantes telles que « J'ai peur de Le Pen, oh là là ! » ?
Voilà qui, usant de la figure de la mère comme d'un cheval de Troie, ne peut manquer décidément d'étonner. Surtout quand on commence à comprendre que, pour Carrère avec Kolkhoze, le Roman russe finit par ressembler furieusement à un Roman ruse.
Là où ce roman russe échoue en cheval de Troie, Collateral, pleinement wittigien, fait exploser les conventions et révèle le matrimoine, le vrai.
Paul Gasnier, La Collision, Gallimard, août 2025, 176 pages, 19 euros
Nassera Tamer, Allô la place, Verdier, collection "Chaoid", août 2025, 192 pages, 18,50 euros
Catherine Millet, Simone Emonet, Flammarion, août 2025, 176 pages, 19,50 euros
Antoine Wauters, Haute-Folie, Gallimard, août 2025, 176 pages, 19 euros
Alexandra Saemmer, Les Zones grises : enquête familiale à la lisière du Troisième Reich, Bayard, collection "Récit", septembre 2025, 304 pages, 20,90 euros
Hélène Laurain, Tambora, Verdier, collection "Chaoid", août 2025, 192 pages, 18,50 euros
Camille de Toledo, Au temps de ma colère, Verdier, août 2025, 160 pages, 18,50 euros
Joanna Russ, Comment torpiller l'écriture des femmes, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Hermelin, préface d'Elisabeth Lebovici, Zones, août 2025, 224 pages, 20 euros
Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard, août 2025, 256 pages, 20,50 euros
Pierre Boisson, Flamme, volcan, tempête : un portrait de Christine Pawlowska, éditions du sous-sol, août 2025, 224 pages, 21 euros
Christine Pawlowska, Ecarlate, préface de Blandine Rinkel, éditions du sous-sol, collection "Souterrains", août 2025, 112 pages, 13 euros
Arno Bertina, Des obus, des fesses et des prothèses, Verticales, août 2025, 256 pages, 20,50 euros
Natacha Appanah, La Nuit au coeur, Gallimard, août 2025 288 pages, 21 euros
Johanna Luyssen, Les Fragments d'Hélène, Julliard, septembre 2025, 208 pages, 21 euros
Ivan Jablonka, La Culture du féminicide, Le Seuil, "Traverses", août 2025, 256 pages, 22 euros
Laurent Mauvignier, La Maison vide, Editions de Minuit, août 2025, 752 pages, 25 euros
Emmanuel Carrère, Kolkhoze, P.O.L., août 2025, 560 pages, 24 euros